

© Peuples Noirs Peuples Africains no. 21 (1981) 8-39
 |
|
Mongo BETI J'ai confié à plusieurs amis, lecteurs ou abonnés de « Peuples Noirs-Peuples africains », que je devais effectuer aux Etats-Unis début avril 1981 un séjour de deux semaines, dont j'attendais une première concrétisation des intentions pannègres inscrites dans notre appellation; aussi, bien avant de partir, avais-je déjà programmé pour le numéro 21 (mai-juin 1981) le récit de ce voyage, sous la forme d'un long reportage que je rêvais d'agrémenter de nombreuses photos; car je désirais en profiter pour faire l'expérimentation, probablement sans lendemain, faute d'argent, d'une formule de publication observée ici et là, à mi-chemin entre la revue classique à la française et le magazine modérément illustré. POURQUOI L'AMERIQUE ? Tout est parti d'ALA (African Literature Association), une association de professeurs américains de littérature africaine; elle organise chaque année, dans une université différente, une conférence à laquelle elle invite des écrivains africains. Comme toutes les organisations [PAGE 9] universitaires, ALA est, derrière une façade d'harmonie et même de bonhomie, le champ clos où s'affrontent progressistes et anti-progressistes, anciens et modernes, en un mot gauche et droite, qui peuvent d'ailleurs se répartir différemment suivant les situations, au gré des débats. Sans aucun doute, ma modeste personne ne suscitait pas l'unanimité au sein d'ALA; mes bons amis de la mouvance du Ministère de la Coopération répandent partout de moi une image d'extrémiste et d'excité qui n'était pas inconnue de l'association où s'activent de nombreux professeurs français nécessairement en liaison avec diverses instances parisiennes ayant des responsabilités en Afrique.[1] Ma présence à une conférence annuelle d'ALA n'était pas souhaitée par tous les membres de l'association, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'avais reçu aucune confidence précise à ce sujet; je n'ai eu besoin que de mon sens de la déduction pour me douter du barrage dressé sur mon chemin. J'avais été l'objet d'un pas de valse-hésitation très significatif en 1980, pendant les préparatifs de la précédente conférence d'ALA. L'un des organisateurs, une Française professeur à Gainesville en Floride, où allait se tenir la réunion, m'avait écrit pour me faire part de l'invitation de l'association. Mais deux ou trois semaines après mon acceptation, voilà qu'elle m'écrit à nouveau pour m'annoncer qu'elle est au regret d'annuler l'invitation d'ALA, l'organisme qui finançait la manifestation avait refusé de prendre mon voyage en charge, faisant valoir que je n'habitais pas l'Afrique et qu'il ne désirait commanditer que les voyages des écrivains africains habitant l'Afrique. Cette argumentation, abstruse et tordue pour un profane, rendait un son avec lequel je suis parfaitement familiarisé. L'idée fixe de certains géniaux manœuvriers parisiens de la politique africaine est de me persuader, à force de pressions psychologiques, de me rallier au dictateur du Cameroun et de m'effacer en même temps devant leur ambition de régenter la littérature africaine. Pour peu qu'on ait l'habitude du fonctionnement de ce type de mécanisme, on imagine fort bien ce qui a pu se passer. L'accord sur mon invitation a dû se faire [PAGE 10] sans ambiguïté dans les débats publics, mais les bureaucrates n'ont pas eu de mal, dans leur paperasse, à vider une décision démocratique de son sens. Entre la tribune et la coulisse, c'est un peu comme entre la coupe et les lèvres. Une discrète enquête faite à Claremont m'a révélé, à mon grand étonnement, que la manipulation n'a pas forcément eu pour instrument ma correspondante, mais un autre membre de l'équipe des organisateurs, qui d'ailleurs n'est pas français. Les pouvoirs sont souvent plus habiles qu'on ne l'imaginerait; il leur arrive d'utiliser en guise d'agents de leurs pressions des personnalités apparemment au-dessus de tout soupçon. Je n'ai donc pas pu assister à la conférence d'ALA de Gainesville en 1980. Bien des membres de l'association, qui me sont favorables, durent s'irriter de ce contretemps et décider d'user de moyens énergiques pour imposer ma présence à la conférence de 1981, qui devait avoir lieu à Claremont, près de Los Angeles. On peut imaginer que, informés de la détermination de l'association, les gens qui veulent m'empêcher de parler, et qu'il faut toujours chercher quelque part à Paris, renonçant à entraver mon voyage, se rabattirent sur une tactique, plus subtile, de paralysie par l'engluage. Agences et organismes en tous genres Sur le moment, je n'ai été que médiocrement intrigué par les agences auxquelles je devais avoir affaire pendant mon voyage; c'est seulement une fois en Californie, à l'occasion d'un incident que je raconterai en son temps que je commençai à soupçonner leur spécificité. L'invitation officielle des organisateurs de la conférence m'a été notifiée par une lettre datée de Claremont 8 décembre 1980, dont ce passage est une allusion sans ambiguïté aux tiraillements existant au sein d'ALA : « ... Le professeur X... qui s'occupe également de la coordination, a pris contact avec l'African Regional Service. Selon les renseignements qui nous ont été fournis, cette agence a pour fonction de favoriser des contacts entre les écrivains africains vivant en France et les centres universitaires et culturels aux Etats-Unis. M. Y... a donc promis de nous prêter son assistance et de se mettre en rapport avec vous. Toutefois nous tenons à vous assurer que, même sans l'aide financière de M. Y.... nous [PAGE 11] 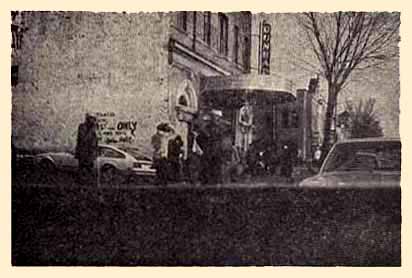 Scène de rue dans le gehetto noir de Washington [PAGE 12] sommes prêts à faire face aux dépenses qu'occasionneront votre déplacement et votre séjour ici... » Si j'avais été plus courageux, j'aurais saisi cette occasion pour signifier aux organisateurs mon refus de tout financement de mon voyage qui ne serait pas le fait d'ALA lui-même. Mais j'étais alors trop curieux de voir un pays où je n'avais jamais été. En 1960, l'ambassade américaine à Paris, agissant par l'intermédiaire de M. Agree, un attaché culturel noir, très sympathiquement connu dans les milieux africains, m'avait bien proposé un voyage en Amérique. Devant alors faire face à des contraintes universitaires, je m'étais poliment dérobé. Je répugnais quand même aussi à voyager sous la protection ostensible d'un gouvernement dont l'impopularité était extrême à l'époque en Afrique et dans d'autres régions du tiers-monde. Je m'en étais un peu mordu les doigts par la suite, en constatant que des gens fort recommandables n'avaient pas redouté de se mettre dans cette position sans en revenir ni discrédités ni pervertis. Je ne puis cacher non plus que j'espérais bien faire des affaires au pays du dollar-roi. Je me doutais que des universités me solliciteraient pour donner des conférences payantes; les sommes ainsi gagnées ne seraient pas de trop pour soulager la trésorerie perpétuellement tendue de « Peuples noirs-Peuples africains » dont nous nous sommes toujours fait un point d'honneur de dire les difficultés. Le fait est que, peu après la lettre m'annonçant officiellement l'invitation à la conférence de Claremont, j'en reçus une autre, venant de M. el Nouty, professeur de littératures francophones à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), qui me proposait en effet de donner une conférence dans son département. Je lui fis connaître mon acceptation sans délai, en lui demandant une rémunération de cinq cents dollars. Il répondit bientôt que cela ne faisait pas de problème, en même temps il me conseilla de veiller à obtenir un visa J-1, indispensable pour être rémunéré sur les fonds publics en Amérique. Enfin je comptais, par ce voyage en Amérique, en quelque sorte tourner l'étouffoir giscardo-francophone où je risquais de périr asphyxié, de même que la malheureuse publication que j'avais eu l'imprudence de fonder, [PAGE 13] sans m'être avisé de prendre la véritable mesure de l'hostilité de l'environnement pour une tribune noire radicale. C'était donc là une manœuvre de débordement dont l'occasion semblait s'offrir à moi providentiellement. Une ou deux semaines peut-être après la lettre de Californie, je fus contacté par un organisme parisien dont la lettre portait l'en-tête : United States International Communication Agency et, plus bas, en plus petits caractères : Africa Regional Services / Embassy of the United States of America. La missive, dont l'acheminement avait été retardé par une erreur d'adresse, disait notamment . « Le Directeur du département de littérature africaine au Scripts College à Claremont, Californie, m'a contacté au sujet d'une invitation à M. Mongo Beti pour participer à une conférence sur la littérature africaine qui se déroulera les 8, 9 et 10 avril prochains sous les auspices de l'African Literature Association, qui est un organisme privé américain et international groupant de 300 à 400 spécialistes qui s'intéressent à ce sujet. Le Directeur pourra, par la suite, vous donner plus de détails, mais il m'a demandé entre-temps de me mettre en contact avec vous afin de savoir si, a priori, cela vous intéresserait. On m'a informé que plusieurs institutions seraient prêtes à vous recevoir – entre autres l'Université de Californie à Los Angeles (USA) qui comporte un programme d'études africaines très important. Etant donnée votre réputation d'écrivain, il est certain que vous seriez très demandé, non seulement en Californie, mais dans d'autres Etats. Il faudrait compter environ un mois pour couvrir ce programme. Serait-ce possible ?... » Flatteuses pour mon amour-propre, ces précisions n'étanchaient pourtant pas ma soif de comprendre. Quelle pouvait être la nature exacte de l'International Communication Agency ? Un simple appendice, apparemment, de l'ambassade américaine. Pourquoi la lettre de Californie ne le précisait-elle pas ? Connaissait-on là-bas le lien unissant L'ICA au gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'ambassade ? Les Etats-Unis passent pour le paradis de l'entreprise privée et des fondations; on est donc toujours un peu gêné de voir le gouvernement américain intervenir, directement ou indirectement, dans des situations où l'on s'attend à avoir pour partenaires des organismes indépendants, moins impliqués dans les [PAGE 14] calculs et les intrigues de la diplomatie américaine, qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, surtout quand elle vient d'être prise en main par un certain Reagan. Je voulus me rassurer quand, étant venu au siège de l'International Communication Agency à Paris, j'y appris que mon voyage se faisait sous l'égide de l'African American Institute, il était donc sous-entendu que l'International Communication Agency n'était qu'un intermédiaire. Je ne voulus pas m'informer davantage, préférant assez lâchement prendre mes désirs pour des réalités. Dans mon esprit en effet, un peu trop enclin à idéaliser l'Amérique, un tel organisme, nécessairement né du désir des Noirs des Etats-Unis de renouer avec le continent de leurs ancêtres, ne saurait être qu'une libre association, quelque chose comme un comité Afrique - Amérique, doté de structures démocratiques et de dirigeants élus et renouvelables. C'est, me semble-t-il, avec des associations ainsi conçues et organisées que les Juifs américains se tiennent en relation étroite avec Israël, avec les conséquences que l'on sait sur la politique américaine au Moyen-Orient. Je me figure, en m'en félicitant, que les Noirs américains ont enfin compris qu'ils devaient imiter les Juifs (et aussi, sans doute, les Irlandais, les Polonais, etc.) s'ils comptaient exercer quelque influence sur la politique du pays dont ils se disent les citoyens à l'égard de l'Afrique. J'allai même jusqu'à imaginer que, pour écarter tout soupçon de servilité à l'égard du pouvoir blanc, l'African-American Institute affichait dans la liste des membres de son conseil exécutif ou de son conseil d'administration un Sam Nujoma, un Nelson Mandela (à titre symbolique) ou toute autre personnalité africaine connue pour son indépendance à l'égard de l'ordre blanc. Je fignolais déjà à part moi le petit speech de retrouvailles, un rien démagogique, qu'il me faudrait prononcer en réponse à la chaleureuse déclaration de bienvenue du président de l'African-American Institute, un vénérable universitaire peut-être barbu, un fringant romancier Prix Pulitzer ou un vieux routier du syndicalisme noir si fertile en combattants d'exception. Le bureau parisien de l'International Communication Agency prit à sa charge toutes les formalités indispensables; [PAGE 15] il s'entremit en particulier auprès du consulat américain pour me faire obtenir le visa J-1 que m'avait conseillé le Professeur Hassan el Nouty, de l'Université de Californie à Los Angeles; je ne manquai pas à cette occasion d'exposer à mes interlocuteurs les raisons mercenaires qui m'amenaient à souhaiter ce type de visa. On me munit, quand je ne fus plus qu'à une dizaine de jours de mon départ, d'une attestation établissant qu'une allocation journalière de 82 dollars m'était accordée, d'un billet d'avion de la compagnie TWA, ainsi que de nombreux documents destinés à faciliter mes formalités à l'aéroport de débarquement et, d'une manière générale, mon entrée sur le territoire des Etats-Unis. Malgré toutes les mentions qui, sur ces documents, impliquaient un contrôle du gouvernement américain, rien, surtout pour un non-anglophone comme moi, n'établissait formellement que mon voyage se plaçait sous la tutelle du Département d'Etat. C'est seulement une fois en Amérique que j'en eus la révélation péremptoire. Pour être sincère, je reconnais que, même si j'avais été dûment informé de la vérité avant mon voyage, je serais néanmoins parti, pour des raisons que j'ai déjà exposées. C'est peut-être le moment de signaler que ce voyage m'a contraint à l'acquisition ou au renouvellement des fournitures que voici : un manteau, un appareil photographique, un magnétophone, une paire de chaussures, des chemises, une valise spéciale pour voyager par avion, soit une dépense globale de plus de 5 000 F. On verra plus loin l'importance de cette information. Dimanche 5 avril 1981 Après une escale à Boston, l'avion atterrit au National Airport de Washington vers 16 h 30. Je ne suis pas surpris par le grand nombre des Noirs aux guichets et derrière les comptoirs de l'aéroport, et aussi comme chauffeurs de taxi, sachant déjà, pour l'avoir lu dans l'Encyclopaedia Universalis, qu'ils forment près de 70 % des 800 000 habitants de la capitale fédérale. Mon interprète accompagnateur, venu m'attendre, n'a eu aucun mal à me reconnaître. Pendant la longue attente des bagages, il me prodigue divers propos d'amitié et de bienvenue. C'est un homme d'une extrême vivacité intellectuelle, parlant français avec tant de naturel que je ne peux [PAGE 16] m'empêcher de lui dire, avec sans doute une nuance de déception : – Vous êtes français, vous ! Comme il me répond que non, j'insiste : – Alors un de vos parents est français ? Ou peut-être vous êtes simplement né en France ? Il proteste fermement de son américanité; du côté de son père il est de vieille ascendance anglaise et d'origine russe du côté maternel. Il a seulement étudié en France et, par la suite, est revenu y séjourner plusieurs fois, en Provence particulièrement. Je suis très médiocrement convaincu, mais je m'abstiendrai désormais de remuer ce sujet. Je garde de cet homme un souvenir plutôt mitigé – ni vraiment bon, ni vraiment mauvais, quoi que je fasse pour me forcer à prendre parti à son sujet. D'abord je n'éprouvais aucune peine à nouer des rapports chaleureux avec lui, facilités par mon admiration pour sa compétence professionnelle, sa culture, l'étendue de son information politique. Je me félicite de ne m'être jamais défié de personne a priori en prenant prétexte de sa nationalité. Trop de gens en France, surtout à gauche, s'effarouchent un peu trop facilement de la présence d'un Américain fringant, familier ou fureteur et ont trop vite fait de voir en lui un agent de la C.I.A. Je suis d'ailleurs persuadé que, de leur côté, les Américains doivent se figurer que tout Africain progressiste est par définition un agent de Moscou. De toute façon, je n'ai jamais eu peur, moi, des espions vrais ou faux, qu'ils soient français, américains, russes ou autres, n'ayant jamais rien eu à cacher, moi qui ne suis ni militant clandestin, ni leader occulte ni détenteur de secrets d'aucune nature. Mais la suite des événements allait me révéler que mon compagnon, s'il avait sur l'Afrique et les Africains des vues générales, confinant le plus souvent au cliché, ignorait tout de l'état d'esprit des Noirs, fussent-ils américains, de leurs préoccupations spécifiques, de leur vision du monde actuel et, plus particulièrement, de leur interprétation de l'histoire. D'autre part, j'ai peu apprécié une maladresse qui ne lui est peut-être pas imputable en définitive. On me le présentera le lendemain à l'African-American Institute comme romancier, et le soir, au dîner, quand je m'enquerrai [PAGE 17] de son œuvre, il s'empêtrera en bafouillant dans une interminable tirade dont je retiendrai qu'il n'a encore rien publié, mais qu'il est en quête d'éditeur pour un manuscrit auquel il vient de mettre la dernière main. Comment un homme de quarante-huit ans, qui devrait avoir derrière lui la partie la plus significative de son œuvre, peut-il accepter de passer pour un romancier, alors qu'il n'a rien publié ? La forfanterie est un vice que j'avais cru jusque-là l'apanage des Latins ou des Africains. Du moins dans les premières heures de notre compagnonnage, je lui sus gré de se mettre en quatre, avec une exquise courtoisie, pour me faire connaître, comprendre et même aimer son pays. Dans le taxi, conduit par un Noir, qui nous emmène du National Airport, il me fait un exposé qui ne manque pas d'humour sur la bizarre géographie du District de Columbia. – Sur cette rive du Potomak, me déclare-t-il, nous nous trouvons encore sur le territoire de l'Etat du Maryland; dès que nous aurons franchi le pont que nous abordons en ce moment, nous serons sur le territoire de la capitale fédérale. Le monument blanc, là, devant vous, c'est le Mémorial d'Abraham Lincoln... J'avoue que je me laisse volontiers séduire par le panorama qui m'apparaît comme un démenti de la carte postale ou de la photo de touriste. On imagine difficilement une voie d'accès plus modeste, moins pompeuse vers la capitale du plus grand empire de l'histoire. Pas la moindre symbole de puissance, abstraction faite de l'autoroute et de son tourbillon de grosses voitures. Le Potomak roule des eaux qui me semblent vraiment boueuses, entre deux rives exemptes de béton, préservées de telle manière que si les autochtones Peaux-Rouges revenaient dans ce monde, j'imagine qu'ils pourraient s'y ébattre sans dépaysement. Je me frotte les yeux de temps en temps pour me convaincre que j'aperçois bien des terrains vagues. La plus petite république bananière de la côte caraïbe doit pouvoir exhiber une entrée plus impressionnante. Justement il fait une chaleur assez lourde, presque moite, qui fait songer aux Tropiques. Tout cela est bien loin de l'enfer des séries de télévision; je suis émerveillé. L'Amérique serait-elle un pays vivable ? [PAGE 18] Nous venons de pénétrer dans le cœur de la cité, et je ne m'en suis guère aperçu. Voici que nous longeons le Département d'Etat, énorme bâtisse sans style, puis l'hôpital où est soigné le président Reagan depuis son attentat. L'établissement est gardé par des policiers assez peu nombreux, en majorité noirs, dans des poses sans aucune agressivité, et même franchement débraillées, pas du tout agacés par le coudoiement des passants. Dans la France de Giscard, il y aurait des C.R.S. partout et l'hôpital présidentiel prendrait des airs de forteresse assiégée et, de ce fait, inaccessible. Nous voici à l'Embassy Square Hotel où je vais loger ainsi que mon interprète accompagnateur. Murs de brique d'un rouge mat. Mobilier de bois et non de métal ou de plastique. Ma chambre donne sur une cour et surplombe une piscine. Le prix de la journée, selon la méthode classique, est marqué sur la face intérieure de la porte d'entrée : 50 dollars! D'une certaine façon, ce n'est pas tellement cher. Etant donné le luxe des lieux, on pouvait s'attendre à quelque très désagréable surprise. Lundi 6 avril Nous avons rendez-vous à dix heures avec les dirigeants de l'African-American Institute. Je découvre avec stupeur que ce sont de jeunes Noirs, autour de trente ans au plus, sapés comme il n'est plus permis, avec costumes trois pièces, gourmette et autres babioles. Ils sont entourés de jeunes femmes, noires elles aussi, passablement indolentes, quelques-unes carrément obèses (les Noirs des deux sexes sont souvent obèses en Amérique). Le siège de l'organisme se trouve au milieu du quartier chic de la capitale fédérale, c'est-à-dire bien entendu dans la ville blanche. Le patron me semble être un certain Bert Laurent, la stature et le muscle avantageux de boxeur poids lourd de téléfilm, genre bellâtre en somme. Il n'y a pas dix minutes que nous sommes en train de discuter avec lui dans son bureau, et je l'ai déjà rangé dans la catégorie des individus peu sympathiques. Je suis déjà assez irrité de me trouver face à un plat bureaucrate, moi qui m'attendais à rencontrer un prophète; pourquoi faut-il qu'il aggrave son cas par [PAGE 19] une colossale autant qu'inexpiable balourdise ? En effet, dès que nous ont rejoints les représentants de l'International Communication Agency, ne voilà-t-il pas que Bert Laurent qui s'exprime dans un français tout à fait convenable entame un laïus sur le rôle de son agence, et sa première phrase déclare à peu près ceci : « L'African-American Institute et l'International Communication Agency sont deux organismes privés, ayant pour fonction, l'un de gérer les bourses de voyage du Département d'Etat, l'autre d'en établir les programmes... » Je suis vraiment outré, ayant ma religion depuis longtemps faite au moins en ce qui concerne l'International Communication Agency dont je me souviens que le bureau de Paris ne cherchait même pas à dissimuler son inféodation à l'Ambassade, donc au Département d'Etat. A l'évidence, on me prend pour un péquenot un peu dur de la cellule grise; là ça commence vraiment mal. Je dois cependant masquer mon dépit. La conversation se poursuivant, j'ai enfin la révélation du statut de mon interprète-accompagnateur; c'est un fonctionnaire contractuel du Département d'Etat. Pour moi désormais, l'African-American Institute, tout comme l'International Communication Agency, est un simple appendice du gouvernement américain. Pourquoi ses dirigeants le cachent-ils, et si maladroitement ? Les Noirs américains n'étant ni assez organisés ni assez dynamiques pour créer des cadres originaux au sein desquels renouer et entretenir librement des liens avec l'Afrique, le pouvoir blanc a évidemment imaginé de combler ce vide, d'instituer ainsi des retrouvailles artificielles entre les Noirs d'Afrique et d'Amérique afin d'en capter tout le profit, tout en désamorçant ce qui serait normalement explosif. Un accrochage à fleuret moucheté se produit tout de même entre Bert Laurent et moi, à propos d'Atlanta. J'avais demandé à Paris que cette ville soit incluse sur la liste de mes étapes dans l'espoir de rencontrer des radicaux noirs de la ville, les Black Panthers par exemple, s'il en restait. Je ne sais pourquoi Bert Laurent crut devoir s'enquérir de mes raisons. Je lui dis que je n'étais pas du tout satisfait par les commentaires des médias de l'establishment blanc de l'Occident à propos des meurtres d'enfants noirs dans les quartiers pauvres de cette ville, [PAGE 20] et que je brûlais de savoir ce qu'en pensent des militants radicaux noirs de l'endroit. – En tant que radical noir francophone, lui dis-je, j'ai cessé depuis longtemps de donner créance au discours officiel ou officieux blanc quand il s'agit des Noirs, aussi bien en Amérique qu'en Europe ou en Afrique. Désormais, s'agissant de Noirs, je n'en crois plus que les Noirs. J'ai le sentiment que la tragédie d'Atlanta est la traduction de quelque chose de très grave. Evidemment, je ne saurais dire quoi au juste. Les militants radicaux d'Atlanta doivent avoir leur petite idée sur cette affaire. Je suis étonné qu'on ne les ait pas entendus jusqu'ici. Je soupçonne que cela doit se passer ici de la même façon que pour nous autres avec les médias français tout puissants : il y a des gens qu'on n'entend jamais. Est-ce que la voix des radicaux noirs n'est pas systématiquement étouffée, comme la nôtre dans le système francophone ? Comme pour discréditer d'avance le témoignage d'adversaires, Bert Laurent déclare : – Il n'y a aucun problème, vous rencontrerez des radicaux à Atlanta; ils ne porteront peut-être pas le titre de Black Panthers, cette appellation n'étant plus tellement d'usage; il s'agira d'activistes sociaux. Bien sûr, leurs témoignages ne manqueront pas d'intérêt. Mais, vous savez, on peut trouver tout ce qu'on veut en Amérique. Si vous voulez absolument des radicaux, okey vous aurez des radicaux. Maintenant si vous voulez des gens raisonnables, ayant à cœur de défendre les intérêts de leur communauté, sans pour autant rompre avec le reste de notre nation, vous pouvez aussi en trouver. Ramenée à l'essentiel, la thèse de mon interlocuteur énonce que la situation actuelle des Noirs dans la société américaine est globalement positive. C'est ce que disent presque toujours les Noirs américains qui ont réussi. C'est un vieux débat, avec lequel il s'est trouvé que j'étais familiarisé – et même doublement familiarisé si l'on considère qu'il nous concerne aussi, nous autres francophones. Je me souviens que, à Paris, dans les dernières années cinquante, le célèbre romancier noir américain Richard Wright, volontairement exilé des Etats-Unis, déclarait à qui voulait l'entendre : « Cela va très mal pour les Noirs en Amérique; leur condition, faite d'injustice [PAGE 21]
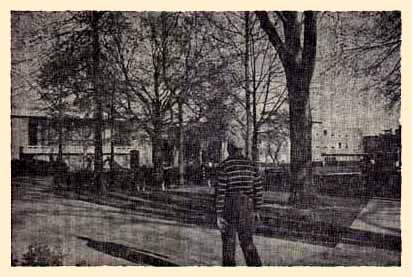 Une vue du campus de Howard University [PAGE 22] et d'humiliation, est devenue intolérable. Attendez-vous à des explosions de violence de la part des Noirs. Le sang va couler. » A quoi Mercer Cook, professeur de français à Howard University en année sabbatique à Paris, répondait confidentiellement : « Richard est un écrivain merveilleux, mais vivant depuis trop longtemps en France, loin de son pays, il est malheureusement coupé de son peuple, dont il ignore les mutations récentes. Les choses s'améliorent chez nous pour les Noirs, lentement, certes, trop lentement, j'en conviens volontiers. L'intégration scolaire, par exemple, est engagée; elle sera achevée dans un avenir qu'on peut déjà prévoir.. » Dix ans plus tard à peu près, apparut le phénomène des Black Panthers qui donna raison à Richard Wright. Vient le moment où l'on me communique le programme de mon voyage. Plusieurs universités y figurent, mais point question de l'UCLA (université de Californie à Los Angeles) où le Professeur Hassan el Nouty m'avait invité dès qu'on sut que j'allais aux Etats-Unis, avec la promesse ferme de rémunérer ma conférence : l'International Communication ne pouvait l'ignorer, puisque son représentant à Paris en avait été informé et l'avait même mentionné dans l'une des lettres qu'il m'avait adressées avant que je me mette en route. Je ne m'émus pas alors de cet oubli pensant que le programme officiel était fondé à passer sous silence une affaire que j'avais conclue à titre privé avec M. Hassan el Nouty. A la fin, on me signe un chèque de 1258 dollars, représentant près des deux tiers de l'allocation de 82 dollars par jour qui m'était attribuée. C'est le seul chèque que je toucherai, et pour cause. Je signale qu'il représente tout juste le montant des emplettes que j'ai dû effectuer avant même de commencer mon voyage. En quittant les lieux, je ne suis pu tellement fier de mon tête-à-tête avec des personnages aussi peu représentatifs de la communauté noire, qui ne les avait jamais mandatés et qui, même, sans doute, ignorait jusqu'à leur existence. Ma contrariété ne venait-elle pas surtout de ce que j'avais dû ravaler les envolées lyriques du discours digne de l'antique si soigneusement concocté – et cela faute de l'auditoire que j'avais rêvé ? Je me demande si un écrivain israélien, irlandais ou polonais venu aux Etats-Unis pour faire un pèlerinage [PAGE 23] des communautés de son ethnie, aurait été livré, comme je l'ai été, à la filière des fantoches. J'avais formulé le désir de rencontrer les incarnations authentiques de la perplexité des Afro-Américains, et on m'avait aiguillé vers la galerie des béni-oui-oui. J'avais rendez-vous dans l'après-midi de ce même jour avec l'international Communication Agency. Cette fois je n'eus en face de moi que des Blancs, et j'en fus choqué. Tout se passait comme si les Blancs devaient tout savoir de ce que font les Noirs, tandis que ceux-ci sont tenus à l'écart de certains secrets. J'eus affaire là en outre à un personnage qui me suffoqua autant que si j'avais rencontré un Esquimau dans son igloo en plein Sahel. Il se disait directeur de la section Afrique noire de la Voix de l'Amérique et s'acharna à me convaincre que je n'avais pas intérêt, pendant mon séjour en Amérique, à faire des déclarations politiques. on aurait cru entendre tel professionnel giscardien de l'Afrique, un Hervé Bourges, par exemple, ou un Claude Wauthier, certainement pas un journaliste américain, tel que le Watergate en a répandu l'image, passionnément dévoué à l'information et à la vérité. Comme il parlait le français sans le moindre accent, je lui dis d'un air qui dut le blesser : – Dites donc, vous êtes français, vous ! Comme mon interprète-accompagnateur la veille, il protesta avec vivacité : – Je suis un authentique Américain, déclara-t-il en postillonnant dans ma direction; c'est vrai que notre tradition de l'information et de l'expression des idées est celle d'une liberté absolue, et j'en suis fier, croyez-moi. Néanmoins, je pense qu'il est de votre intérêt de ne pas tout dire, tant que vous serez ici – et en particulier de ne pas faire des déclarations trop virulentes contre le président Ahidjo. Je commence à me persuader que mes bons amis des services secrets giscardiens ont dû me précéder ici, dans l'intention de me miner le terrain sous les pieds. L'esprit de domination produit partout le même type d'hommes. Après l'oncle Tom-Senghor, voici le paltoquet blanc : les deux font la paire. Il y a certainement des gens à qui je ne tarderai pas à déplaire, car dès le lendemain, je me gardai bien de [PAGE 24] laisser passer la meilleuse occasion qui me fut donnée de faire des déclarations fracassantes. Ce fut pendant ma visite à l'Université noire de Howard. Mardi 7 avril C'est le jour de ma visite à l'Université noire de Howard, où nous devons nous trouver avant 2 heures de l'après-midi. Ma plus forte émotion de la journée, et même la seule grande émotion de mon voyage, je l'ai éprouvée en traversant en taxi le ghetto noir de Washington, qui cerne précisément l'université Howard. On a beau entendre parler de la misère du prolétariat noir américain, on a beau l'imaginer, on ne peut s'en faire une idée un peu précise à moins d'en avoir observé de visu les stigmates. Cela ne ressemble en rien à la pauvreté relative dont les quartiers populaires des grandes villes d'Europe donnent le spectacle, morne grisaille qui ne dépouille l'être humain ni de sa dignité ni de son espérance. Comparé à la ville blanche, le ghetto m'est apparu comme un autre univers, un peu ce que doit éprouver le néophyte du dépaysement qui, après avoir quitté Saint-Germain-des-Prés, est transporté en quelques heures au cœur d'un bidonville d'Afrique occidentale ou équatoriale, ou du Bangladesh. Est-ce l'immensité du secteur, son abandon flagrant de champ en friche, l'épiderme des populations ? J'ignore ce qui m'a suggéré l'image d'une brousse, d'une vaste savane, mais elle s'est lentement imposée. Les rues rectilignes m'ont rappelé les pistes rouges creusées à même la latérite, au bord desquelles défilaient des constructions basses comme des cases accroupies, séparées par des terrains vagues grouillant d'enfants à moitié nus au pied desquels l'œl se surprenait à guetter les ébats d'une poule ou d'une chèvre. J'avais toujours cru que la plupart des Noirs américains étaient métissés; dans les foules qui nous entouraient quand le taxi était arrêté par un feu rouge les gens avaient la peau aussi noire que moi dans leur écrasante majorité. Je m'étais figuré que, voyageur africain, je ne résisterais pas au plaisir d'entrer dans un bar et, malgré mon anglais impossible, de nouer un échange fraternel avec le premier consommateur noir; [PAGE 25] si j'ai éprouvé une tentation, ce fut plutôt de prendre les jambes à mon cou bien que je ne fusse à aucun moment descendu du taxi. Dans cette Cour des Miracles, les portes des buvettes évoquent l'entrée peu engageante d'une vespasienne; toutes les façades des maisons sont en ruines ou gravement détériorées; les fenêtres exhibent des carreaux de carton, à défaut de vitres. Des montagnes d'immondices trônent ici et là sur des trottoirs creusés de fondrières. Le seul équipement en bon état ici, c'est la chaussée : il faut bien que le flot des voitures continue à déferler. Tant pis s'il doit fouler un peuple désarmé, éventrer ses douars, souiller ses sources vives. Je suis intrigué par la fréquence d'attroupements compacts d'hommes debout sur le trottoir, surtout aux croisements des rues. Au premier rassemblement, j'ai songé à un cortège de manifestants près de s'ébranler, mais on ne voyait nulle banderole, nul poing levé. J'ai ensuite pensé à un piquet de grève, mais aucune façade, aucun pignon d'usine nulle part; j'ai enfin cru à une fête, mais je n'ai aperçu aucune fanfare à l'horizon, l'allégresse et l'exaltation ne semblaient agiter aucun des acteurs. De guerre lasse, je pose la question qui me tourmentait à mon interprète. Il me dit sans hésiter : – Je crois qu'il s'agit chaque fois de gens qui attendent le passage du trafiquant de drogue, du « dealer ». – Quoi! ça se fait dans la rue, au vu et au su de tous ? – Euh ! oui... – Voulez-vous dire que le gouvernement et la police savent que cela se passe de la façon que nous voyons en ce moment ? – Sans doute. – Donc si le gouvernement voulait mettre fin au trafic de la drogue, il saurait où frapper. – Oui, mais il y a les contraintes de la démocratie, qui font qu'on ne peut pousser la répression du trafic de stupéfiants au-delà d'une certaine limite, sans menacer gravement les droits de l'individu. Il en a de bonnes, lui! Ce sont sans doute les mêmes contraintes de la démocratie qui empêchent d'en finir avec le Klu-Klux-Klan ? C'est une réflexion que je me fais à part moi, bien entendu. Pour le moment, je me garde [PAGE 26] d'engager une polémique avec mon accompagnateur; je pourrais l'effaroucher, il serait capable de rentrer dans sa coquille. Or plus j'en entends, mieux cela vaut. Je me fixe cela comme règle de conduite. Du taxi, je prends quelques photos en cadrant à travers la vitre; je désire obtenir une vue éloquente que je publierais dans la revue avec cette légende : scène de rue dans le ghetto noir de Washington. Ma conférence à Howard est à l'image de ce qui m'est arrivé lors de mes passages dans les universités d'Europe et du Canada. Comme partout le thème qu'on me demande de développer ici est d'une extrême banalité : l'écrivain africain et l'engagement. Dans mon idée, les foules estudiantines du monde entier doivent être écœurées par la redondante inconsistance de la problématique que ce terme est censé recouvrir. Il n'en est rien ici, apparemment. Cependant deux traits m'ont paru distinguer Howard des universités européennes. D'abord, le ton de l'échange est très vite devenu militant et, contrairement à ce que j'ai observé en Europe, aucune voix ne s'est élevée pour tenter d'atténuer le blâme déversé par les interventions successives sur les dictateurs africains au service du néo-colonialisme. Il est vrai que nous étions quasi exclusivement entre Noirs et que l'argument souvent entendu en Europe (peut-être aussi en Amérique, dans des circonstances différentes) selon lequel la démocratie en Afrique se heurterait à la multitude et à la diversité des tribus, ce qui rendrait indispensable la démarche autoritaire, d'ailleurs conforme à la tradition africaine, relève de l'idéologie blanche, c'est-à-dire d'une incontestable nostalgie esclavagiste. Au contraire l'assistance surenchérit spontanément dans l'exécration des dictateurs oncle Tom. Plusieurs jeunes étudiants africains se lèvent successivement et, tour à tour, démontrent qu'il convient de confondre dans la même dénonciation les dictateurs noirs, les oppresseurs blancs, européens et américains, et même la bourgeoisie noire américaine, à laquelle il est fait grief de collaborer avec le Blanc pour maintenir l'Afrique sous la domination du capitalisme. Autre trait caractéristique, on semble être passé maître ici dans l'art de faire rendre le maximum au visiteur – jusqu'à ses entrailles mêmes, s'il est possible. [PAGE 27]
 Autre vue du campus de Howard University [PAGE 28] Ainsi nous fait-on plancher debout pendant trois bonnes heures, mon Interprète et moi, dans une chaleur qu'un printemps précoce (qui ne le sera pas longtemps) rend étouffante. L'université engrange sans vergogne un matériel pédagogique de toute première valeur : il y a là un magnétophone pour m'enregistrer et une caméra vidéo pour filmer les débats de bout en bout. Ce n'est pas tout. Décidément, rien n'aura été épargné à un professeur de lycée français déjà vidé par les rigueurs hivernales et la longue durée du deuxième trimestre. – A la télévision maintenant! m'enjoint-on. L'université Howard possède en effet une chaîne de télévision commerciale, qu'elle exploite elle-même. C'est là que votre serviteur, l'agitateur tant redouté des journalistes gouvernementaux qu'ils font une jaunisse rien qu'à l'idée qu'il pourrait prendre la parole en public, va jeter ses plus beaux feux. Mon intervieweuse noire, qui a assisté à ma prestation de l'après-midi, décide de centrer, elle aussi, ses questions sur les problèmes de l'engagement. Très militante de ton, elle aussi, ne voilà-t-il pas que, sans en avoir été sollicitée par moi d'aucune façon, comme pourraient témoigner les assistants, elle me pose cette question dévastatrice : – Vous vivez en exil en France depuis plus de vingt ans, n'ayant jamais accepté de reconnaître la légitimité du président de votre pays, le Cameroun. Quelles sont vos raisons pour refuser de reconnaître la légitimité du président Ahidjo ? Je me jette aussitôt sur l'occasion, comme la misère sur le pauvre monde. Si le petit paltoquet de la veille eut ce soir-là l'idée de capter la chaîne Howard, il a certainement fait une crise d'apoplexie et il doit avoir pris une location définitive au cimetière de son quartier. Et de déballer toute ma marchandise. Et d'exposer en long, en large et même en travers qui est le président du Cameroun – le pantin d'une puissance impérialiste, le petit chef d'un gang de massacreurs à gages, un boucher dont les mains dégoulinent du sang des patriotes camerounais, etc. Ce fut incontestablement le temps fort de la petite demi-heure que dura l'interview. Ensuite séance de démaquillage, au milieu de l'agitation traditionnelle d'un studio de télévision, dans une atmosphère extrêmement décontractée. Tout le monde [PAGE 29] est noir ici, à l'exception de mon interprète. Le patron est là, mais se tient modestement en retrait. Pas de petit chef. Le représentant de l'ordre est une jeune femme noire, hanchue, distante, lasse, la traditionnelle étoile de fer blanc accrochée au sein. Pour la première fois, j'ai enfin le sentiment de découvrir les Noirs américains. Rien de guindé ni de théâtral, je ne sais quoi de primesautier, de fraternellement « vulgaire », dans le sens étymologique du terme, qui déplaît (il me le dira plus tard) à mon interprète, ancien d'une université aristocratique, Princeton. Je n'en reviens pas de voir, dans un studio de télévision, des Noirs dont les initiatives et le comportement soient spontanés et autonomes, dont les propos ne reflètent aucune pression externe. C'est bien simple, dans le système « francophone », il y aurait des intrus blancs partout, et pas seulement aux postes prétendus techniques. Je suis quand même surpris qu'au pays du dollar-roi aucun salaire ne me soit proposé en compensation de toutes ces longues heures d'un travail accompli, au moins à l'université proprement dite, dans des conditions remarquablement pénibles. Je me garde d'en rien dire pour le moment, me promettant de guetter plus tard l'occasion d'épancher mon amertume. Mercredi 8 avril Le voyage de Washington à Los Angeles dure plus de cinq heures; il est vrai que l'avion doit faire un crochet à Chicago où l'attente de la correspondance ne dure pas moins d'une demi-heure. Néanmoins, quatre fuseaux horaires séparant la côte est de la côte ouest des Etats-Unis, Il n'est pas plus de onze heures du matin quand nous atterrissons à l'aéroport de Los Angeles, d'où nous ne nous envolerons qu'à midi passé sur un coucou à qui il faut une vingtaine de minutes pour franchir quelque soixante-dix kilomètres et nous déposer à l'aéroport d'Ontario. De là un taxi nous emmène en une vingtaine de minutes aussi à notre hôtel de Claremont. Sous le ciel bleu et le soleil éclatant de Californie, le décor de maisons basses, ocre et rose, imitant le style mauresque importé jadis d'Espagne, est féerique. Je me lèverai pourtant le lendemain sous un ciel bouché, au milieu d'une [PAGE 30] sorte de crachin rappelant fâcheusement la Normandie à la fin de l'automne. Deux surprises m'attendent à Claremont où je dois séjourner le temps que s'achève la conférence, soit du mercredi 8 avril, jour de notre arrivée, au dimanche 12 avril, jour du départ pour Atlanta. A l'hôtel, la réception nous attribue une seule chambre, à mon interprète et à moi-même. Révolté, je déclare aussitôt qu'il n'est absolument pas question que je partage ma chambre avec qui que ce soit, et que j'aimerais mieux reprendre l'avion immédiatement et quitter les Etats-Unis. Au comble de l'étonnement, lui aussi, du moins autant que je puisse en juger, mon compagnon, qui bégaie d'indignation, exige des explications. La réception expose alors que le bureau de Washington de l'International Communication Agency, qui avait d'abord retenu deux chambres par téléphone, a le matin même annulé une des locations, affirmant que ses deux voyageurs se contenteraient d'une grande chambre à deux lits. – Mais c'est totalement contraire à nos traditions, voyons ! s'écria mon interprète. Il convient avec moi que c'est une situation d'autant plus absurde que ce n'est pas l'ICA qui règle nos séjours en hôtel, mais nous-mêmes avec notre allocation journalière de quatre-vingt-deux dollars. De quel droit cette agence prétend-elle nous contraindre à dormir dans la même chambre ? Ces gens-là sont devenus fous; je ne vois pas d'autre explication. Qu'est-ce que c'était que cette histoire ? Pourquoi voulait-on que nous dormions ensemble ? – Ecoutez, me fait mon compagnon, laissez-moi m'occuper de cette affaire. Je vous garantis que ça ne se passera pas comme ça. Permettez-moi de vous accompagner dans votre chambre et de vous aider à vous installer. Ensuite j'irai téléphoner à Washington pour leur dire ce que je pense de leurs étranges procédés. Je vous rendrai compte, vous verrez. Jamais personne ne m'a demandé une chose pareille. Ma deuxième surprise ne tarde pas.
A peine installé, je reçois un appel téléphonique de l'université de Claremont. On m'apprend que ma conférence à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) est annulée. [PAGE 31] – Annulée ? mais pourquoi ? fis-je, consterné. – Eh bien, voilà ! Ne sachant pas où vous étiez exactement, et encore moins si vous arriveriez aujourd'hui à Los Angeles, le Pr Hassan el Nouty, la mort dans l'âme, a préféré tout annuler. Vous comprenez, les gens vous attendaient pour 2 heures cet après-midi. M. Hassan el Nouty n'a pas pu obtenir l'assurance que vous pourriez vous trouver aujourd'hui à cette heure-là à Los Angeles. Il a pourtant téléphoné à Washington. – Et alors ? – Eh bien, à l'International Communication Agency, on lui a répondu qu'on ne savait pas où vous vous trouviez ni, à plus forte raison, à quelle heure vous arriveriez à Claremont ni même si vous arriveriez aujourd'hui. Voici le téléphone de M. Hassan el Nouty qui vous confirmera lui-même tout ceci. M. Hassan el Nouty confirme en effet ces informations au téléphone et achève de me désespérer en m'apprenant que la brièveté de mon séjour en Californie du Sud et la relative proximité du week-end lui interdisaient de programmer à nouveau ma conférence. Cela signifie concrètement pour moi que je n'ai plus qu'à faire mon deuil de la rémunération de cinq cents dollars que devait me rapporter ma conférence. Je sens que je vais exploser, tellement je bous de colère. Je parviens à me maîtriser à grand-peine, en songeant qu'il faut que je sois d'abord absolument certain de la mauvaise foi de l'International Communication Agency avant d'accabler ces gens-là. Je me penche donc sur le document où mon programme est détaillé jour par jour et que j'ai toujours à ma portée. Or on peut y lire à la page 2 que, le mercredi 8 avril, je m'envole à 7 h du matin du National Airport de Washington, à bord du vol 53 de la compagnie American Airlines, qu'à Chicago je prends une correspondance à 8 h 50 du matin à bord du vol 181 de la compagnie American Airlines en direction de Los Angeles, d'où je repars à 11 h 25 du matin, à bord du vol 796 de la compagnie Golden West, en direction d'Ontario où je dois arriver à midi. Avec de tels renseignements il est clair que n'importe qui, et a fortiori un professionnel, était à même de me contacter mercredi matin entre Washington et Claremont pour m'annoncer que j'étais attendu à 2 h de l'après-midi [PAGE 32] à Los Angeles pour ma conférence par le Pr Hassan el Nouty. Malgré un échange substantiel de correspondance avec mon hôte, je n'avais jamais été informé de cette précision d'horaire, rendue difficile pour des raisons techniques, je suppose. Jusqu'à la fin, je ne m'en étais pas inquiété, convaincu que dans ces conditions, la conférence aurait automatiquement lieu le soir, après le dîner, comme cela se fait presque toujours en Europe. J'ai déjà dit plus haut que je fus quelque peu étonné de ne pas voir le programme qu'on me proposa à Washington mentionner ma conférence à l'UCLA; j'ai déjà dit aussi pourquoi, finalement, je men inquiétai peu. Mais il était impossible qu'à l'African-American Institute ou à l'International Communication Agency l'on pût ignorer mon rendez-vous avec le Pr Hassan el Nouty. Non seulement il est mentionné, comme on l'a vu, dès la première lettre du bureau parisien de l'ICA; mais de plus pour justifier ma demande d'un visa J-1, conseillé par le Pr Hassan el Nouty, j'ai expliqué de vive voix à mes interlocuteurs de l'ICA de Paris que j'allais donner une conférence payante à l'UCLA. Ce serait trop peu dire que j'étais fou furieux, le dessein de sabotage ne pouvant plus faire de doute dans mon esprit. Vers la fin de l'après midi, mon interprète m'appela au téléphone pour m'annoncer triomphalement qu'il venait de résoudre le problème de son hébergement; il logeait dans une chambre située au même étage que la mienne. – Il faut que je vous parle sérieusement, lui dis-je. Voulez-vous que nous nous retrouvions dans le hall d'entrée de l'hôtel ? – Okey. Je lui exposai, je dois dire sans aucune sérénité, l'affaire de ma conférence annulée à l'UCLA; il en parut abasourdi. – Vous comprenez, poursuivis-je, on a tout fait à l'ICA pour me faire manquer ma conférence chez des gens qui, eux au moins, avaient accepté de me payer, contrairement à Howard. Et d'abord pourquoi n'ai-je pas été payé à Howard, hein ? Howard m'a pressé comme un citron, vous le savez bien vous. Mais à Howard, personne n'a songé à me payer qu'est-ce que ça signifie tout ça ? – Je suis vraiment désolé, fit-il, quand j'eus achevé ma tirade, [PAGE 33] moi-même je ne comprends pas vraiment. Je vais essayer de contacter Washington malgré l'heure tardive. Reparlons-en demain. D'accord ? Quelle journée ! Je remontai vivement dans ma chambre et me mis en devoir de consigner ces événements dans mon journal; ils m'inspiraient une méditation où revenaient des idées qui m'étaient chères depuis longtemps. Dans un pays où il était de tradition que chacun monnaye son talent au prix fort, pourquoi m'empêcher, moi, et systématiquement, de tirer le moindre profit pécuniaire de mon voyage ? Dans mon esprit, des consignes sévères devaient circuler à mon sujet dans les administrations intéressées. Le spectacle du ghetto de Washington me revint tout à coup en mémoire. Dans un pays aussi puissant, aussi prospère, l'extrême et persistant dénuement des Noirs peut-il vraiment se comprendre par référence aux seuls mécanismes socio-économiques ? L'abjection des descendants des esclaves africains n'était-elle pas plutôt organisée et entretenue délibérément ? Quel merveilleux instrument que la pauvreté pour barrer à une communauté les chemins de la liberté! Chacun savait bien, par exemple, que je mettais tout l'argent que je gagnais dans « Peuples noirs-Peuples africains ». En me privant de toute rémunération, c'est à l'évidence la revue que j'avais fondée qu'on voulait étrangler. Et puis le maître blanc a besoin de bonne conscience; il lui faut se persuader que le nègre est paresseux, celui-ci travailla-t-il dix fois plus que lui-même. Si le nègre est paresseux, il faut qu'il soit pauvre, sinon ce ne serait pas moral. Du moment qu'il est pauvre, la preuve est faite qu'il est paresseux et qu'il a mérité sa pauvreté de toute éternité. Le fondement du système idéologique, c'est donc d'abord et avant tout la misère du nègre; c'est elle qu'il faut instituer in principio. La recette ? Le faire trimer gratis, pardi! Moi-même n'avais-je pas été amené là, plus de cent ans après l'abolition de l'esclavage, pour trimer gratis ? Dans le monde blanc, l'esclavage du nègre tend à s'ériger en fatalité. Et dire qu'il m'avait d'abord été proposé que mon voyage dure un mois! Il avait fallu que j'explique longuement et patiemment pourquoi en France un professeur ne pouvait s'absenter si longtemps de son lycée, et que si la conférence de Claremont n'avait pas coïncidé [PAGE 34] avec les vacances, de Pâques, je n'y aurais pas participé. Etait-il vraiment possible que l'on ait comploté dans quelque sphère du pouvoir américain de me faire une tournée d'un mois de conférences gratuites aux Etats-Unis ? Eh bien, moi, j'avais une parade simple et toute prête j'allais purement et simplement interrompre cette guignolade. Jeudi 9 avril Je ne revis mon interprète que le lendemain au petit déjeuner. Il m'apprit qu'il avait justement eu la chance de rencontrer la veille au soir, après notre conversation, une dame professeur à Howard, qui avait participé à la préparation de ma visite à l'université noire – malheureusement, elle n'avait pas pu nous rencontrer, ayant dû rallier Claremont deux jours avant l'ouverture de la conférence d'ALA. Elle lui avait fait une révélation qui, apparemment, l'avait stupéfié, mais ne me surprit pas. Selon elle, l'International Communication Agency avait téléphoné à Howard avant mon arrivée, pour conseiller aux organisateurs de ne pas me payer ma conférence, étant donné que ce problème avait déjà été résolu par le Département d'Etat. – Comment! m'écriai-je, j'ai été rémunéré par le Département d'Etat, moi ? Je ne suis pas au courant. Quoi ! les 82 dollars par jour peut-être ? C'est ça ? Eh bien, elle est raide, celle-là! C'est un fait que cette fameuse allocation journalière couvre à peine les frais quotidiens du voyageur, aussi longtemps du moins qu'il ne s'est pas résigné à adopter le mode de vie des Spartiates. J'ai constaté que, dans les hôtels où l'ICA, renseigné, je suppose, par des agences de voyage réservait pour nous par téléphone, une chambre coûte 50 dollars à Washington (plus de 250 F), 45 dollars à Claremont (qui est une banlieue en somme de Los Angeles). Un repas à la française (entrée, viande, légumes, dessert), mais sans vin, a vite fait de grimper jusqu'à 12 et même 15 dollars. Certes, on est souvent nourri aux frais de la compagnie dans l'avion à bord duquel on voyage; il arrive aussi que l'on soit invité à un cocktail et que l'on n'ait plus faim en en sortant. II arrive malheureusement aussi que l'on doive faire face à [PAGE 35] des dépenses imprévues; les transports urbains, c'est-à-dire principalement le taxi au moins dans les villes où je me suis trouvé, sont bien plus coûteux qu'on ne croit d'abord. On peut aussi être contraint de téléphoner à sa famille – ce fut mon cas à plusieurs reprises. Enfin, pour voyager aux Etats-Unis, je n'avais pas cessé d'être l'animateur d'une publication et, à ce titre, de me tenir en liaison aussi étroite que possible, avec au moins ceux de mes amis résidant en France. Le compte est donc vite fait : 45 dollars en moyenne (estimation minimal ) d'hôtel, 25 dollars de repas, quelques courses de taxi, une communication téléphonique temps en temps, et les 82 dollars sont épuisés. Gardez-vous surtout d'aller au café, la moindre consommation coûte les yeux de la tête. Telle est la généreuse rémunération que le Département d'Etat daignait me consentir pour mes conférences ! Mon interprète me révéla en autre que c'est aussi un responsable de l'ICA, une certaine Mme Erin Hubbert qui, au téléphone, avait répondu au Pr Hassan el Nouty qu'on ne savait pas où je me trouvais le mercredi 8 avril entre sept heures et midi. – Ecoutez-moi bien, lui dis-je, vous allez téléphoner à Washington et sommer, je dis sommer l'ICA et l'AAI d'appeler les universités auxquelles je dois encore rendre visite pour modifier toutes les consignes qui leur recommandaient de ne pas me payer mes conférences. Nous sommes le jeudi 9 avril. Il faut absolument que d'ici dimanche, jour prévu de notre départ d'ici pour Atlanta, je tienne la garantie formelle que ces modifications ont bien été faites dans le sens que je souhaite. Sinon, c'est bien simple, je reprends l'avion dimanche pour l'Europe. LA RUPTURE Il promet de transmettre mes exigences à qui de droit, sans paraître cette fois ému outre mesure. Curieusement, il commençait à m'exaspérer, celui-là. Mon infortune, dont je ne manquai pas de parler à la conférence d'ALA, fit beaucoup de bruit, les professeurs américains reconnaissant eux-mêmes que l'attitude des autorités à mon égard était sans précédent. Le lendemain, vendredi 10 avril, je ne lui touche pas un mot de l'affaire; lui, de son côté, [PAGE 36] se garde bien de m'en parler. Mais au repas de clôture de la conférence d'ALA, qui occupa toute la soirée, il se fait fâcheusement remarquer, en témoignant ostensiblement sa réprobation tout au long du discours d'apparat prononcé par George Lamming, un écrivain noir de la Barbade, très célèbre dans les pays anglophones, dont l'humeur narquoise fort encline à brocarder la volonté de puissance de l'Oncle Sam, s'exhale tantôt en formules incisives d'un humour typiquement britannique, tantôt en tirades théâtrales et pathétiques à la Fidèle Castro. A peine George Lamming a-t-il déclamé la dernière période de sa péroraison, et alors que les salves d'applaudissements font trembler la vaste salle du festin, accompagnées d'un brouhaha assourdissant, on se précipite sur moi de toutes parts. Nous étions en effet placés de façon à être le point de mire de toute l'assistance. – Il est bizarre, ton interprète, me chuchotent les anglophones en s'essayant dans la langue de Molière, il ne serait pas de la C.I.A. par hasard ? Tu devrais te méfier. – Il n'est pas franc du collier, ton mec, me chuchotent les francophones, des fois qu'il serait homo, hein ? Tu ne te méfies pas assez, toi aussi. Tu sais, les homos, c'est en général des types pervers en politique aussi. Je reconnais que les Noirs sont souvent affreusement intolérants. Il n'empêche que j'ai rarement vu un Blanc susciter des réactions aussi négatives dans un public de Noirs. J'ignore évidemment dans quel dessein le Département d'Etat m'a collé ce personnage; ce qui est certain, c'est qu'il a manqué de flair et même de jugeote. Je me répète avec amertume le restant de la soirée que, en ce genre d'affaires, les Américains ne sont décidément pas plus astucieux que les Français, contrairement à mes premières illusions. Les intellectuels noirs, quand ils peuvent exprimer librement leurs sentiments, supportent très mal que les Blancs prétendent rejeter leurs responsabilités historiques à l'égard du destin tragique des peuples noirs à travers le monde. Cela ne signifie pas qu'ils méconnaissent la bonne volonté et la sincérité de certaines catégories de Blancs. L'attitude de mon interprète avait été aussi stupide qu'injustifiée. Le lendemain matin, samedi 11 avril, il me fait part des conversations téléphoniques qu'il a eues avec [PAGE 37]
 A la TV de Howard university : le géant, derrière l'interprète, c'est Francis Ward, directeur des informations [PAGE 38] ses supérieurs hiérarchiques. Il est difficile sinon impossible de faire faire demi-tour en si peu de temps à une administration. Il serait préférable que je termine d'abord mon voyage. On verrait ensuite à me faire parvenir un honorarium une fois que je serais revenu à Rouen. – Bon, ça va, j'ai compris, lui dis-je, je repars dès que possible. Malheureusement pour ce samedi soir, des étudiants noirs, africains et américains, venaient de m'inviter à une party privée dans une maison qu'ils louaient en commun au cœur de Los Angeles. J'avais accepté d'y aller, désirant rencontrer des Noirs en dehors des rites officiels. C'est seulement le lendemain, dimanche 12 avril, étant aux Etats-Unis depuis seulement huit jours au lieu des 16 prévus, que je repris l'avion et quittai l'Amérique. Je n'ai pas cherché un clash avec mes hôtes, pourtant je ne regrette pas, je me réjouis même que nos rapports aient pris cette tournure orageuse que j'aurais été parfaitement incapable d'imaginer à mon départ; un voyage ordinaire aurait donné lieu à un récit banal et ennuyeux : en effet que peut aujourd'hui dire d'instructif sur les Etats-Unis un voyageur qui aurait emprunté les sentiers battus ? Au contraire, le conflit n'est-il pas depuis toujours, pour nous autres nègres, le mode de connaissance idéal, sinon le seul mode de connaissance de l'univers des Blancs ? Après quinze jours d'observations laborieuses, je n'aurais jeté en pâture aux lecteurs de Peuples noirs-Peuples africains que des méditations empruntées. Par le raccourci de l'affrontement, j'ai au contraire fait jaillir quelques étincelles de nature à jeter des lueurs nouvelles sur une certaine Amérique, trop peu connue encore, celle qui s'apprête à se substituer en Afrique aux anciennes puissances coloniales décidément en perte de vitesse. Car c'est ainsi, à mon humble avis, qu'il faut interpréter mes petites avanies. Jusqu'à une époque récente, les Américains qui manifestaient de l'intérêt pour les Africains et les approchaient, suscitaient une sympathie durable et justifiée. Comme les Canadiens et les Allemands pendant un certain temps, ils étaient auréolés d'innocence, ne nous ayant pas colonisés, ou ayant oublié combien ils avaient jadis contribué à notre avilissement. Hommes de science, [PAGE 39] esthètes, universitaires, intellectuels las de la suffisance de l'Occident et en quête de vérité, ils étaient mus par une modestie et une sincérité qui tranchaient avec le cynisme brutal de nos ex-colonisateurs. Aussi notre admiration, rendue plus naïve par l'ignorance qu'avait trop longtemps cultivée l'obscurantisme du colonisateur, nous faisait-elle oublier l'Amérique lyncheuse de nègres, à tel point que, dans certains pays africains, et plus particulièrement en Afrique centrale, l'impérialisme américain tendait à se draper dans les voiles vaporeux du mythe. Il est vrai que, mobilisé par les zones traditionnelles de son emprise, l'Oncle Sam s'obstinait alors à regarder ailleurs. Tout change très vite de nos jours, hélas! Il arrive aujourd'hui à cette avant-garde dont le désintéressement s'était égaré en marge de la mainmise des multinationales ce qui est arrivé naguère en Afrique Centrale aux Allemands de l'Ouest, aux Canadiens, aux Russes, à tous les systèmes de domination blanche : la volonté de puissance du super-capitalisme américain a tourné vers nous les naseaux fumants de sa face de taureau, ayant découvert que notre sous-sol recélait des richesses plus fabuleuses que les mines du roi Salomon. A la vague inoffensive des pèlerins dénués de calcul se mêlent désormais, plus ou moins clandestinement, d'audacieuses cohortes au service de ce qu'on a coutume d'appeler le monstre froid. Sous la bonhomie avenante qui nous charmait chez leurs prédécesseurs, ils dissimulent des appétits implacables; derrière les salutations fraternelles, ils insinuent des prétentions effrontées; avec les bourrades, ils assènent des pointes qui foudroient. En un mot, ils ont résolu de nous prendre en main, pour notre plus grand bien faut-il le préciser ? Dieu merci ! nous connaissons maintenant la chanson.
Mongo BETI [PAGE 40]
 A la Conférence d'ALA, à Claremont (Californie). De gauche à droite : l'interprète Kenneth Adams, Mongo Beti et Dennis Brutus
[1] Cet article date d'avant l'élection de F. Mitterrand |