

© Peuples Noirs Peuples Africains no. 55/56/57/58 (1987) 220-260
 |
|
« BARDÉE DE DIPLÔMES » ET LA NÉCESSITÉ DE LA LUTTE POUR LA DÉMOCRATIE AU KAMERUN Siméon KUISSU La situation économique et politique du Kamerun remplit d'inquiétude non seulement les Kamerunais mais aussi les étrangers qui ont des intérêts à défendre dans ce pays. Elle déçoit les Africains et beaucoup « d'amis de l'Afrique » qui avaient placé des espoirs dans « l'exemple Kamerunais ». Beaucoup de gens semblent surpris par l'ampleur de la dégradation de cette situation, mais bien peu de gens vont au fond de la réflexion sur ses causes, et se contentent trop souvent des lieux communs qui sont habituellement avancés pour expliquer toutes les difficultés des pays sous-développés, et qui gravitent autour de la crise mondiale et de la détérioration des termes de l'échange. Pourtant, il n'y a de surprenant dans l'évolution du Kamerun sous le régime de M. Biya que la rapidité avec laquelle les choses se sont détériorées sur tous les plans. En effet ce qui arrive est la conséquence de la crise du néo-colonialisme, crise qui se développe sous nos yeux depuis les dernières années du règne d'Ahidjo, et contre laquelle l'U.P.C. avait mis Biya en garde dès novembre 82 en ces termes : « ... Si ce dernier (M. Ahidjo) a battu en retraite, nul doute que son valet, Paul Biya, n'a pas plus d'atout pour bloquer le changement. La crise qui a acculé Ahidjo à la démission ne pourra donc que s'approfondir : elle acculera Biya à la faillite s'il ne change pas de cap. » L'originalité de M. Biya et de son équipe du R.D.P.C. a été seulement d'imprimer leur marque personnelle et particulièrement néfaste à cette évolution. A – La faillite économique de système néo-colonial Tout comme la crise globale du régime de dictature du parti unique néo-colonial, la faillite économique actuelle résulte de l'accélération d'un processus inhérent à la nature même du néo-colonialisme. Les mécanismes économiques structurels de l'exploitation néo-coloniale sont les causes fondamentales du sous-développement. Tout a été dit sur le néo-colonialisme économique, et pourtant il faut chaque fois le redire, en dégager les caractéristiques essentielles pour les avoir constamment à l'esprit. Ceci est d'autant plus nécessaire qu'en cette période [PAGE 221] de crise aiguë fleurissent toutes sortes de théories qui prétendent expliquer ce qui nous arrive en oubliant sciemment l'essentiel. L'incurie évidente de M. Biya et de son équipe ne suffit pas pour expliquer toute la situation. Nos relations économiques avec les pays étrangers ont lieu essentiellement avec les pays occidentaux, en tête desquels vient la France. Ces relations sont marquées par le phénomène de l'échange inégal : « La croissance des prix à l'importation l'emporte en permanence sur celle des prix à l'exportation... »[1]. En 1981/82 par exemple les prix à l'importation ont augmenté de 62 %[2] alors que les prix de nos produits de base n'ont augmenté que de 28,8 % pour le cacao, 27,7 % pour le café, 12,5 % pour le coton. La couverture (en valeur) des importations par les exportations était en 1970 de 86 % et en 1984 (hors pétrole) de 66 % seulement. Cela veut dire : 1o Que les échanges sont déséquilibrés au détriment du Kamerun et 2o que ce déséquilibre va en s'accentuant d'année en année. Cette détérioration des termes de l'échange fait que nous devons produire toujours plus pour importer des quantités équivalentes de marchandises. C'est-à-dire que les Kamerunais doivent travailler toujours plus, créer toujours plus de plus-value pour acquérir la même marchandise occidentale, c'est-à-dire la même plus-value parfois même une plus-value inférieure étant donnée l'augmentation de la productivité du travail dans les pays capitalistes développés. Il y a donc transfert de plus-value vers ces pays. C'est cela l'échange inégal. Cette inégalité ne résulte pas seulement de la différence de productivité du travail entre le Kamerun et la France, elle est l'expression d'un rapport de force. En effet ce sont les pays capitalistes qui fixent à la fois les prix des produits qu'ils nous vendent, et les prix des produits que nous leur vendons. Ils ne fixent pas les prix, ils les imposent ! car la variation de nos prix est tendantiellement à la baisse constante et ceux de leurs prix tendantiellement à la hausse constante. Dans ces conditions nos économies souffrent dès le départ d'un handicap insurmontable économiquement. Comment un enfant qui est continuellement saigné peut-il être en bonne santé, et à plus forte raison se développer ? Pour permettre le développement du pays, il faut d'abord lever cette hypothèque. Nous en sommes au 6e plan quinquennal de développement (1986-1991) mais, 27 ans après l'indépendance, on attend toujours le décollage économique que l'on annonce comme imminent depuis plusieurs années. Le 5e plan quinquennal (1981-1986) n'a pas été correctement réalisé. C'était prévisible et nous l'avions dit[3]. On ne peut en effet assurer le développement économique en comptant essentiellement sur les financements extérieurs (56 %), en négligeant les industries industrialisantes, [PAGE 222] en laissant le système bancaire et le crédit aux main des étrangers qui transfèrent chez eux les fonds indispensables à l'investissement. En 1984, les investissements étrangers au Kamerun ont été de 88,8 milliards CFA tandis que dans la même période, 181,1 milliards ont été transférés à l'étranger[4]. On reconnaît officiellement[5] que, « Prévue initialement à 40 % de l'enveloppe financière globale du 5e plan, la part effective du secteur privé ne représente que 25 % au terme des trois premières années d'exécution de ce plan ». De source occidentale on confirme que le financement des investissements n'a atteint que 50 % des sommes prévues, en moyenne. Ce taux est plus bas dans certains secteurs, et au contraire plus haut dans les secteurs improductifs ou de prestige tels que les équipements administratifs et la construction des ministères où les crédits prévus ont été dépassés. Selon les sources officielles[6] en général surévaluées, ce taux a été de 64 % pour les routes par exemple. Or les routes sont vitales pour notre économie (76 % du trafic marchandise et 92 % du trafic passagers). La réalisation récente de quelques axes routiers lourds, attendus depuis l'indépendance, ne doit pas faire oublier cet échec. – Dans le domaine de la santé, seulement 17 % des infrastructures, 39 % de la formation professionnelle et 32 % du recrutement du personnel prévus ont été réalisés. – L'agriculture par contre s'est bien tenue, avec 86 % de la production prévue dès la 4e année. Ceci prouve que 10 l'essentiel de l'effort national repose sur les paysans. L'agriculture représentait 31 % de PIB en 1978 (avant le pétrole) et 21 % en 1985 (pétrole compris). Le pétrole et toutes les ressources minières ne représentaient que 11,5 % du PIB en 1985. 20 Lorsque les projets de développement reposent avant tout sur l'effort national, (cas de la production agricole) ça marche mieux que si tout est attendu des investissements extérieurs (cas des routes par exemple). Le 6e plan, (86-91) pour les mêmes raisons que le 5e et les autres, ne sera pas réalisé. De plus, les orientations économiques qui y sont définies ne correspondent pas à la réalité : d'un côté on prétend que « la mise en place d'unités industrielles de grande dimension dont les études seront lancées au cours du 6e plan devra être le reflet de la volonté politique manifeste de doter le pays d'une base industrielle autonome »[7], de l'autre on se prépare à privatiser les grandes entreprises d'État qui devraient servir de base à la construction de ces unités. D'un côté on veut donner la primauté au développement des PME nationales sur les investissements étrangers, de l'autre on asphyxie ces mêmes PME par un système de crédit anti-national. D'un côté on veut, pour mettre le pays à l'abri des fluctuations des cours mondiaux des produits bruts, promouvoir l'exportation de produits transformés ou manufacturés sur place qui ont effectivement plus de valeur sur le marché international que les produits de base, de l'autre, la part de ces derniers produits dans nos exportations ne cesse de baisser. D'une part on veut promouvoir le commerce extérieur, de [PAGE 223] l'autre on ferme les délégations à l'étranger du C.N.C.E. (Centre National du Commerce Extérieur), ou on réduit leur budget. Lorsqu'on part pour un long voyage et qu'on trébuche dès le premier pas, c'est mauvais signe. Le budget 87/88, qui marque le début de l'application du 6e plan a été révisé en baisse de près de 20 % ! Au transfert de plus-value s'ajoute la fuite des capitaux Le système bancaire est entièrement conçu pour drainer les fonds du Kamerun vers l'étranger. Toutes les 10 banques commerciales du Kamerun appartenaient à des étrangers jusqu'à ce que James Onobiono devienne actionnaire majoritaire de la « Bank of America ». Mais la Bank of America est une petite banque, comparée aux 9 autres, comme le montrent leurs actifs au 30.6.85 (tableau 1); on se demande d'ailleurs pourquoi Onobiono a pu obtenir si vite ce que M. Lélé demande en vain depuis de nombreuses années : une banque camerounaise. Chacun se souvient de l'opposition du gouvernement, notamment de M. Ntsama, à l'ouverture de la banque Lélé, dont le projet remonte aux années Ahidjo ! Ces 10 banques drainent tous les dépôts y compris au moins 16 % des dépôts de l'État; mais les fonds publics dans ces banques dépassent 16 % si on y inclut les sommes colossales déposées par les entreprises d'État, en particulier l'O.N.C.B.P., la C.N.P.S., et les fonds du compte hors budget rapatriés en secret de l'étranger et qui proviennent essentiellement, mais pas exclusivement – des ventes pétrolières. Que font ces 10 banques commerciales de cet argent ? Elles le transfèrent à l'étranger vers les places financières où les taux d'intérêt sont plus élevés, pour les livrer à la spéculation financière. Ces transferts sont visibles et légaux et n'ont rien à voir avec l'évasion secrète de capitaux qui relèvent de la fraude ou des détournements de fonds. Mais les deux phénomènes s'additionnent pour priver l'économie kamerunaise de l'épargne nécessaire à l'investissement. C'est ainsi que la balance des opérations courantes est chroniquement déficitaire : – 6,1 % du PIB en 78, – 7,1 % de 79 à 81, + 1,2 % de 82 à 85 (effet pétrole). Si, dans notre balance des paiements, la balance commerciale est excédentaire (+ 12,4 % en 1980, + 56,5 % en 83), la balance des services, qui représente essentiellement le transfert des revenus du capital et le remboursement de la dette, est quant à elle toujours déficitaire (– 39,6 % en 1980, – 187 % en 1983)[8], c'est ce qui est officiellement reconnu dans le 6e plan[9] : « Du côté de la balance des paiements le déficit structurel des invisibles contrebalance la tendance à l'excédent commercial généré par le mouvement des marchandises observé depuis 1983-84 ». En fin 85, les dépôts extérieurs des banques kamerunaises se montaient à 163 milliards. Avec la croissance cancéreuse de la spéculation financière en Occident, ces dépôts ont certainement considérablement augmenté depuis 1985. Comme l'a écrit notre camarade Koss[10] « Il est inadmissible, surtout dans un pays sous-développé, qu'une bonne partie des fonds bancaires (près du quart) !) soit placée à l'étranger, alors que les banques se financent pour plus de 80 % à partir des ressources locales ! [PAGE 224]
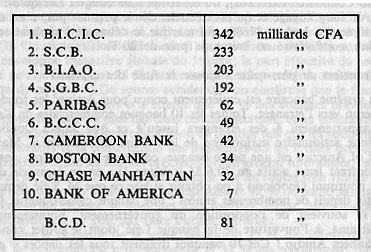
Jusqu'à quand l'argent des Kamerunais continuera-t-il de financer les marchés financiers et les entreprises de certains pays industrialisés ? » Tous les discours de M. Biya sur la nouvelle stratégie industrielle, visant à faire moins de grosses entreprises produisant des biens de substitution à l'importation, et à favoriser plus les PME est absolument vide de sens quand on sait que l'État n'a aucun pouvoir sur les banques, qui sont toutes privées et presque toutes étrangères, et ne peut donc pas orienter le crédit. La structure du crédit consenti par les banques à partir des liquidités qui restent dans le pays est incompatible avec l'investissement productif; 73 % des crédits sont à court terme, 26 % à moyen terme, et seulement 1 % à long terme[11]. On avoue officiellement que « Pour ce qui est de la participation bancaire au développement, l'orientation et la structure des crédits bancaires n'obéissent pas toujours aux objectifs des différents plans quinquennaux du fait de la rigidité structurelle de mobilisation des crédits, du placement des fonds à l'extérieur par les banques en quête d'une meilleure rémunération et surtout de l'insuffisance des fonds propres ». Ainsi, les activités du secteur tertiaire et notamment celles à caractère commercial et immobilier, sont encore privilégiées dans la distribution des crédits notamment à court terme (90 % de l'ensemble des crédits) au détriment de l'agriculture et des PME/PMI »[12]. Reste la 11e banque, la B.C.D. (Banque Camerounaise de Développement) : elle ne fait pas le poids face aux 10 larrons. En 1985 elle n'a pourvu que 3,3 % des crédits à l'économie, contre 78,3 % pourvus par les banques commerciales, et 18,4 % des crédits publics provenant de la B.E.A.C.[13]. Bien qu'étant une donnée particulière aux anciennes colonies françaises, les effets négatifs de notre appartenance à la zone franc doivent être [PAGE 225] considérés comme structurels, car ils sont inhérents aux mécanismes d'exploitation par les néo-colonialistes français : sous prétexte de garantir les monnaies africaines, la France spolie les membres de cette zone de leurs recettes en devises. Celles-ci sont en effet obligatoirement déposées au Trésor français où chaque État africain se voit attribuer un compte dit d'opération, et où il doit racheter les devises nécessaires à ses transactions hors de la Z.F. Quand ce compte est excédentaire, ce qui est le cas pour le Kamerun par exemple depuis plusieurs années, le Trésor français ne paie pas d'intérêt mais dispose de ces devises à sa guise. A l'inverse, quand le compte est déficitaire, l'État africain paie des agios. Quand ce déficit est chronique, la France ne garantit plus le pays concerné. En somme, la France ne garantit « la monnaie » d'un pays africain que dans la mesure où l'économie de ce pays garantit la sienne. De surcroît, le franc CFA (colonie française d'Afrique, rebaptisée communauté financière africaine après 1960) étant lié par une parité fixe au franc français (1 FF = 50 CFA), les économies africaines subissent fâcheusement les contre-coups des dévaluations successives du FF dans leur commerce en dehors de la Z.F. Ce mécanisme fait de la France, selon le mot de l'économiste kamerunais le regretté Tchundjang Pouémi, « le seul pays au monde à avoir réussi l'extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres ». C'est un formidable moyen de pression sur les pays africains pour les obliger à commercer avec la France. C'est un atout d'une importance capitale entre les mains de la bourgeoisie française dans la concurrence avec les Nords-Américains, Japonais et Ouest-Allemands en Afrique. Il est indispensable d'avoir présentes à l'esprit ces données structurelles, fondamentales, constantes, pour aborder la crise économique actuelle. En effet, cette attitude évite de tomber dans l'erreur qui consisterait à faire porter toute la responsabilité de la crise actuelle sur M. Biya et son équipe en ignorant les causes lointaines et profondes du sous-développement. Cette erreur est grave dans la mesure où elle entraîne automatiquement l'illusion qu'il suffirait de changer M. Biya et son équipe pour que tout aille bien. D'autres ont déjà fait cette erreur en 1982 en s'imaginant que le remplacement d'Ahidjo par les « technocrates bardés de diplômes » allait résoudre la crise. Or il n'en n'a rien été. Ce n'est pas seulement d'un changement d'hommes que le Kamerun a besoin, mais d'un changement de cap, de politique. - Les imperfections du capitalisme tropical : Bien qu'il fût, pendant 7 ans, le premier ministre d'Ahidjo qui l'avait soi-disant chargé des questions économiques, Paul Biya n'a pas inventé les défauts de l'économie kamerunaise. Cet homme peut-il inventer quelque chose ? On retrouve les mêmes travers dans les économies des pays voisins, à des degrés divers. La plupart des déséquilibres de gestion actuels existaient au cours de la période Ahidjo. La tentation est irrésistible de reproduire ici le texte de la motion de soutien des hommes d'affaires kamerunais à P. Biya en 1983, énonçant leurs griefs à la gestion [PAGE 226] d'Ahidjo : « La Communauté des hommes d'affaires camerounais réunis ce jour à la Chambre de Commerce, d'industrie et des Mines du Cameroun à Douala, sous la présidence de M. Noucti Tchokwago, président de la Chambre de Commerce, adresse la motion de soutien suivante à son Excellence Paul Biya, Président de la République et chef de l'État : Considérant le désordre qui régnait dans l'économie camerounaise au moment de votre accession à la magistrature suprême, désordre caractérisé par :
2) Un oubli volontaire des vrais hommes d'affaires au profit d'aventuriers sans patentes, ni autres titres réglementaires, aventuriers ayant perturbé profondément les circuits commerciaux et donnant ainsi à notre pays l'apparence d'une économie saine (sic); 3) Un octroi complaisant des crédits bancaires sans garanties ni possibilités de remboursements; 4) Une tolérance voire un encouragement d'une fraude douanière organisée; 5) Une généralisation des contrebandes par terre, mer et air ; 6) Une libre circulation sur notre territoire national d'une monnaie n'ayant pas cours dans nos banques... Condamnons avec la dernière énergie les individus nostalgiques d'un passé féodal et révolu (sic) pour leurs activités criminelles ayant menacé de porter atteinte à la sécurité de la République » Ils pourront refaire la même motion au successeur de Biya. Cette description pourrait s'appliquer à quelques variantes près, en changeant l'échelle de magnitude, à l'économie du Nigeria voisin par exemple. Elle s'applique à la situation actuelle au Kamerun qui présente les mêmes déséquilibres : – Les crédits sont distribués sur des bases tribales et de copinage à la faveur de la « bêtisation » de la direction de la presque totalité des banques et institutions financières, et au détriment des authentiques acteurs de l'économie nationale. Ces crédits ne sont pas remboursés et sont considérés par les banques comme de l'argent perdu. Au temps d'Ahidjo, les bénéficiaires de ces largesses prenaient la précaution de « mourir » et de « renaître » sous un faux nom pour échapper à toute poursuite. Aujourd'hui, les bénéficiaires de cette manne ne se cachent même pas. Ils sont là en chair et en os, arrogants et insolents vis-à-vis des agents de recouvrement. Ces créances cumulées au 30.6.86 se montent à 174 milliards ![14] – La sous-traitance des marchés publics est systématique. Ils sont attribués souvent à des individus étrangers aux affaires, qui vont ensuite les négocier avec les professionnels de l'économie. Ceux-ci présentent leurs devis en général surévalués car ils y intègrent le coût du risque [PAGE 227] inhérent aux retards de paiement de I'État. Les factures présentées à l'administration sont celles des bénéficiaires du marché qui ajoutent aux devis des professionnels, qu'ils gardent sur eux, leurs marges bénéficiaires. Comme ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, cette manipulation aboutit en général au doublement, c'est-à-dire à une surfacturation de 100 %, qui obère lourdement les finances publiques. – La corruption et les détournements de fonds publics connaissent leurs plus beaux jours sous le règne du « renouveau » et de la « moralisation », ce qui a fait pousser ce cri d'horreur à Etame Nlédi, patron du syndicat unique du R.D.P.C. dans le Wouri : « Je voudrais dire que nos lois et règlements pour la survie de notre économie, devront être respectés de telle manière, non pas qu'on brandisse la rigueur et qu'on clame la Moralisation, alors pourtant que le népotisme, le principe de deux poids deux mesures, en somme toutes les formes de gangrène sociale hypothèquent le développement et le progrès du Cameroun, à force de fermer les yeux sur toutes sortes d'immoralités ». – La fraude fiscale et douanière continue en effet comme avant. La contribution des recettes douanières au budget de l'État a diminué en valeur relative : 109 milliards en 1980 (52 % des recettes budgétaires) à 169 milliards en 1984 (31,8 % des recettes budgétaires). Le montant de la fraude fiscale serait environ égal au montant des sommes effectivement recouvrées. Les liquidités ainsi soustraites aux finances publiques et aux circuits normaux de l'économie par toutes ces malversations, sont placées dans les banques des pays occidentaux, ou dépensés bêtement, le plus souvent à l'étranger, dans des achats de luxe. Cette exportation illicite de capitaux, véritable détournement de fonds vient s'ajouter aux transferts des banques commerciales pour anémier l'économie. Pour la seule période de mai et juin 1987, près de 300 milliards CFA sont ainsi sortis de notre pays. Dans ces conditions, on mesure le ridicule des accusations plus ou moins officielles selon lesquelles les « tontines » sont la cause de l'assèchement des liquidités des banques. C'est vraiment chercher une querelle d'Allemand aux hommes d'affaires qui pratiquent cette méthode traditionnelle d'épargne. Dans un contexte où le système bancaire n'est plus fiable, où vous ne pouvez pas retirer l'après-midi ne serait-ce qu'une partie de votre argent déposé le matin à la banque, où la banque ne vous accorde pas de crédit pour financer votre affaire, et surtout où une trop grande partie de l'argent du pays s'en va à l'étranger, le recours aux tontines n'est pas seulement une réaction instinctive de conservation, c'est une mesure de sauvegarde de l'économie nationale, dans la mesure où l'argent des tontines reste et tourne dans le pays. Cet argent est un apport vital pour le secteur dit informel. On désigne ainsi tout ce qui n'est ni du secteur moderne (grosses entreprises privées et parapubliques, fonction publique) ni du secteur rural. Il regroupe donc les 40 000 PME du Kamerun qui emploient moins de 10 personnes, les professions libérales, et la foule des « débrouillards ». L'importance économique de ce secteur informel est considérable : De source occidentale confirmée par les données officielles [PAGE 228] (6e plan) on estime qu'il emploie 400 000 personnes, c'est-à-dire autant que les secteurs privé et parapublic réunis, plus que la fonction publique (170 000), et qu'il a créé environ 20 000 emplois par an de 1980 à 1984, soit autant que les secteurs privé et parapublic réunis, plus que la fonction publique (8 000). Le problème des sociétés d'État L'existence d'entreprises publiques dans les économies capitalistes tropicales ne s'explique pas par les mêmes raisons que dans les économies des pays capitalistes développés. Dans les pays capitalistes développés, les entreprises publiques quand elles existent, comme en France, en RFA ou en Grande-Bretagne, sont nées au cours du développement du capitalisme, comme pour atténuer les effets néfastes du capitalisme sauvage tels qu'on peut les observer actuellement aux USA par exemple. Tandis que dans nos pays, l'État s'est improvisé « capitaliste » parce qu'il n'y avait pas de capitalistes privés. La bourgeoisie kamerunaise alors naissante ne disposant pas du capital suffisant pour créer de grandes entreprises, l'État a fourni les capitaux avec l'intention déclarée de rétrocéder plus tard ces entreprises au secteur privé dès qu'il serait capable de racheter les parts de l'État. Ainsi fut mise sur pied là S.N.I., holding par laquelle transitent les participations de l'État dans la plupart de ces sociétés. Aujourd'hui le secteur public occupe une place prépondérante dans l'économie nationale. Avec plus de 60 entreprises entièrement ou majoritairement publiques, ce secteur intervient dans tous les domaines de l'activité économique : agriculture, industrie, commerce, services. Selon les sources occidentales, il représente 40 % de la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière, 7 % du PIB c'est-à-dire plus de la moitié de l'apport de cette industrie au PIB, qui est de 13 % derrière l'agriculture (25 %) et le pétrole (17 %). Avec 50,7 milliards d'investissement en 1984, la S.N.I. intervient pour 6,2 % de la formation brute de capital fixe. Ainsi présentées, les entreprises publiques pourraient constituer un levier entre les mains de l'Etat pour orienter l'économie, garantir la réalisation des plans quinquennaux, et donc contribuer à la croissance économique. Or il n'en n'est rien. En proie à de grosses difficultés, ces entreprises constituent globalement plutôt une charge pour l'État. La mission de la Banque Mondiale et du F.M.I. commandée par Biya pour faire le « diagnostic » des maux dont souffrent les sociétés d'État a retenu pas moins de 10 causes des performances décevantes de ces sociétés :
– projet sans logique économique; – excès de personnel;; – structures bureaucratiques; – pas d'incitation à une bonne gestion; – objectifs mal définis; [PAGE 229] – poursuite d'objectifs sociaux sans compensation financière claire politisation de la gestion; – manque de flexibilité dans l'adaptation aux circonstances du marché; – structure de financement inadéquate (recours excessif à l'emprunt). Selon cette mission de la B.M., bien peu parviennent à l'autofinancement, et la plupart perdent de l'argent :
40 milliards en 1984, 52 milliards en 1986. Les champions de cette hémorragie sont CELLUCAM (fermée en 1986), CAMSUCO, ALUCAM qui, à elles trois totalisent la majorité des pertes. Les mesures de restructuration et de réhabilitation de ces sociétés, proposées par la commission gouvernementale tiennent en un mot : privatisation. Il ne faut pas privatiser : Plusieurs considérations militent contre la privatisation des sociétés d'État comme solution à leurs difficultés : la première c'est que la raison même qui a justifié au départ l'engagement de l'État existe toujours. Certes, depuis 1960 s'est formée une bourgeoisie kamerunaise. Mais la surface financière de celle-ci reste faible, comparée à la bourgeoisie occidentale. Elle a augmenté son capital pendant ce quart de siècle, mais la bourgeoisie occidentale a augmenté le sien encore plus, grâce au mécanisme de l'échange inégal. Ce mécanisme de l'exploitation néo-coloniale ne lèse pas seulement les travailleurs, mais aussi les patrons kamerunais qui voient leur échapper la plus grande partie de la plus-value créée au Kamerun et transférée à l'étranger. Le gouvernement est conscient de cette considération puisque ses amis occidentaux lui prêtent la pensée suivante. « Face au manque de ressources d'investissement et à l'expérience industrielle limitée du secteur privé national, le gouvernement considère toujours nécessaire de parrainer les investissements dans les secteurs productifs, mais avec l'objectif de transférer ces investissements au secteur privé après une certaine période de temps, dès que possible (quand ?). Seules les activités stratégiques, comme les services publics, les hydrocarbures, et certaines industries de base resteraient sous contrôle de l'État ». Il y a contradiction à affirmer d'une part que le secteur privé national manque de ressources d'investissement et d'expérience industrielle et d'autre part à établir un programme de privatisation à court terme (5 ans). Cette contradiction apparente traduit probablement les pressions auxquelles est soumis le gouvernement kamerunais de la part de la B.M. et du F.M.I. Elle confirme le point de vue de l'U.P.C. selon lequel la libre concurrence, le libéralisme prôné par les impérialistes pour [PAGE 230] l'Afrique signifie la loi du plus fort, et la privatisation dans ce contexte, une recolonisation économique directe. La deuxième considération c'est qu'il y a quelque chose de scandaleux et de profondément injuste à donner à des individus privés le fruit du travail de la collectivité nationale. Ceci est valable même si le secteur privé national était capable de racheter les parts de l'État. Racheter est un bien grand mot, car on sait, à partir d'autres expériences de privatisation ailleurs, comment les choses se passent : entre les copains et les coquins. De plus, au Kamerun, en l'absence de cotation boursière, comment sera fixé le prix de l'action ? La troisième raison, la raison fondamentale, c'est qu'il ne suffit pas de changer le titre de propriété d'une entreprise pour que, comme par un coup de baguette magique, elle se redresse et marche. Ce n'est pas le titre de propriété qui est la cause des difficultés des entreprises d'Etat ! S'il en était ainsi, il n'y aurait pas de canards boiteux parmi les entreprises privées, et des entreprises saines parmi les sociétés d'État. La réalité c'est que les lois du marché, les critères de gestion économique s'imposent à toute entreprise, privée ou publique, qui veut faire du profit. Pourquoi le propriétaire qu'est l'État ne pourrait-il pas les appliquer comme le font les propriétaires privés ? L'État doit veiller à ce que la création et la gestion des entreprises d'État répondent à une logique économique, aux lois du marché, aux critères de gestion économique et sociale. Ainsi ces entreprises pourront à la fois faire du profit et s'intégrer harmonieusement dans l'ensemble de l'économie nationale. La tentation de l'État de vouloir résorber (bien faiblement d'ailleurs) le chômage de manière administrative en engageant une pléthore d'employés dans les entreprises publiques est erronée. L'excès de main-d'œuvre quand elle est réelle, tue l'entreprise. Alors qu'une entreprise qui tourne bien dégage des profits qui peuvent être réinvestis dans d'autres secteurs pour créer de nouveaux emplois, des emplois productifs facteur de développement et non des emplois parasitaires qui au contraire freinent le développement. Il peut paraître paradoxal aux yeux de certains, qu'un upéciste, partisan du socialisme par définition, défende le profit. Il ne s'agit pas d'un profit abstrait. La grande différence entre deux entreprises qui font du profit, mais l'une appartenant à l'État et l'autre au secteur privé, est que le profit de l'entreprise d'État bénéficie à la collectivité nationale tandis que le profit de l'entreprise privée ne bénéficie qu'à un groupe d'hommes, voire à un individu seul. Mais il faut aussi préserver un certain profit privé. Dans la sociétê kamerunaise telle qu'elle est actuellement, il y a des bourgeois détenteurs de capitaux, des petits bourgeois détenteurs du savoir-faire économique, technique et technocratique, et la grande masse des ouvriers et paysans dont le travail crée l'essentiel de la richesse nationale. Et tout ce monde aux intérêts divergeants, parfois contradictoires doit vivre en harmonie dans un même pays. La condition principale de cette vie commune c'est une répartition acceptable des richesses nationales. Il faut payer mieux les travailleurs, mais il faut aussi rémunérer le capital. Il n'est pas question de [PAGE 231] jeter les riches à la mer ou dans la fosse aux lions. Il est question de les amener à partager. Pour que les entreprises d'État soient bien gérées et que leurs profits bénéficient à tous, il faut que l'État soit démocratique. Pour que les profits du secteur privé ne soient pas excessifs et ne compromettent pas l'équilibre social, il faut aussi que le pays soit démocratique. Seule la démocratie permettra aux syndicats de défendre leur pouvoir d'achat, et aux organismes de contrôle d'obliger le secteur privé à payer la douane et les impôts, à des taux par ailleurs démocratiquement fixés. – Les effets de la conjoncture sur l'économie nationale Le régime a pour toute explication à ses difficultés économiques la crise mondiale. Chacun sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la seule explication, ni même la principale. Mais il est bien vrai, par contre, que la crise du capitalisme mondial retentit négativement sur les économies des pays sous-développés. N'importe quel gouvernement kamerunais qu'il soit réactionnaire ou progressiste, ou même upéciste, aurait à faire face à des difficultés dues à la conjoncture internationale, mais il y a probablement d'autres façons d'y faire face, avec plus de succès que M. Biya, dans un pays comme le Kamerun. 1. L'effet pétrole (tableau 2, p. 232) Il y a eu les années fastes. Il y a maintenant les années noires. Mais le plus dur, concernant le pétrole est devant nous, si on en croit les prévisions des milieux occidentaux bien informés. La production pétrolière a commencé en 1978 et fut cachée pendant plusieurs années au peuple kamerunais. Négligeables au début, les revenus pétroliers nets pour le Kamerun, tous frais déduits et la part des compagnies pétrolières payée, ont été multipliés par 10 en 5 ans, passant de 43 milliards en 1980 à 406 milliards CFA en 1985. Bien que la production ait augmenté en 86 atteignant 9 millions de tonnes, les revenus pétroliers en 86 n'ont pas été supérieurs à ceux de 85, du fait de la chute du prix du baril. Si les royalties versées par les compagnies pétrolières sont budgétisées et représentent 1/4 du budget de l'État, l'essentiel des revenus pétroliers (environ les 2/3) est viré dans un compte hors budget (C.H.B.) à l'étranger en dehors du trésor français. Cette disposition présentée par le régime comme une marque de prudence, pour que « le pétrole ne tourne pas la tète aux Kamerunais » est en réalité une disposition scélérate qui met ces fonds à la discrétion du chef de l'État Ahidjo d'abord, Biya ensuite. Les louanges dont se couvre le régime kamerunais et qui sont relayés par les milieux occidentaux, au sujet d'une prétendue « gestion saine, responsable et prudente »[15] sont largement immérités. Si la gestion était si saine, il n'y aurait pas besoin de cacher l'argent du pays dans un C.H.B., d'où les retraits et les rapatriements de fonds sont opérés dans le secret. Que des fonds ainsi rapatriés et budgétisés aient permis le financement de certains [PAGE 232]
[PAGE 233] grands travaux, l'embauche dans la fonction publique, un certain investissement économique en maintenant la dette extérieure à des niveaux assez bas, ne doit pas faire oublier que les deux chefs d'état successifs ont largement pioché dans le C.H.B. pour eux-mêmes, et ont gaspillé beaucoup de cet argent dans des réalisations de prestige. L'effondrement des prix à la fin de 1985 a entraîné un manque à gagner important, aux effets d'autant plus néfastes qu'ils coïncidaient avec la diminution de la production et du cours du dollar. Si la gestion avait été « saine, prudente et responsable », ce mauvais coup aurait trouvé dans nos réserves financières une parade qui eût mis notre économie à l'abri de la tempête. Mais les réserves étaient biens basses... Si la production continue au rythme de 8 millions de tonnes/an, elle devra s'arrêter dans un peu plus de 5 ans (et peut-être moins si le prix continue à baisser) car les réserves d'exploitation rentable sont évaluées à 40 millions de tonnes seulement. Ce n'est pas seulement « une gestion saine, prudente et responsable » qu'il faut, mais un projet économique tenant compte de cette donnée. L'effet dollar Le pétrole étant payé en dollars, on imagine que le passage du cours de cette monnaie de 500 F CFA à 250 F CFA, en gros, entraîne une réduction de moitié de nos revenus pétroliers. Ce n'est pas entièrement juste. Un dollar vaudra toujours un dollar. De sorte que nos achats dans la zone dollar ne devraient pas être affectés par la dépréciation de cette monnaie. Quand la France dévalue son franc, cela n'affecte pas nos échanges avec elle, mais seulement nos échanges hors de la zone franc. Ce qui est néfaste c'est l'obligation de passer par le trésor français pour changer nos dollars, ce qui nous fait subir tous les reculs du franc français face aux autres monnaies, sans bénéficier de ses raffermissements face à ces monnaies quand nous voulons changer des CFA en devises. La chute des cours des produits agricoles de base devrait, elle aussi trouver une parade dans la caisse de l'O.N.C.P.B. L'O.N.C.P.B. prélève sur les revenus des produits de base. Ces prélèvements sont en principe destinés à stabiliser le revenu des planteurs, en soutenant le prix qui leur est payé lorsque les cours mondiaux chutent. Mais on observe sur l'exemple du cacao (tableau 3, p. 234) que l'écart entre le cours mondial et le prix au paysan est toujours important, parce que les ristournes aux planteurs sont insuffisantes et parce que de nombreux intermédiaires au Kamerun et à l'étranger se servent au passage. Même les amis occidentaux de M. Biya avouent que les revenus agricoles servent plus à financer le gouvernement qu'à rémunérer les paysans. Étant donné le volume énorme des sommes détenues par l'O.N.C.P.B. (l'agriculture représente 22 % du PIB en 1984), cette caisse devrait jouer un rôle important dans l'économie nationale, non seulement en soutenant le revenu des paysans, mais aussi en soutenant l'investissement et en permettant au pays de résister au choc des effondrements périodiques [PAGE 234]
[PAGE 235] des cours mondiaux des produits de base. L'O.N.C.P.B. ne peut assurer ce rôle en raison de 2 handicaps : d'une part elle dépose tout son argent dans les banques commerciales (les 10 larrons), et celles-ci comme on le sait les transfèrent à l'étranger pour spéculer ou pour financer les économies des pays riches ! D'autre part depuis que le biyaïsme a vidé les caisses de l'État, celui-ci prélève dans les caisses de l'O.N.C.P.B. pour faire face à ses difficultés de trésorerie, notamment pour payer les fonctionnaires. En somme le paysan est « grugé » 3 fois, et même 4 fois : 1er coup : on prélève (trop) sur le fruit de vente à l'étranger de sa production. 2e coup : il paie des impôts sur ses maigres revenus. 3e coup : les technocrates fanfarons de Biya pillent les caisses de l'État (et donc les impôts des paysans). 4e coup : le paysan doit repayer par le biais de l'O.N.C.P.B. pour que l'État puisse contenter ses technocrates. C'est une sorte de 2e impôt indirect et intolérable ! Selon le Président de la République (discours télévisé de février 1987), les effets conjugués de la baisse du prix du pétrole, du cours du dollar et des prix des produits de base ont fait perdre à notre pays 200 milliards de F CFA en 1986. Ce n'est pas la mer à boire pour le Kamerun, dont le produit intérieur brut de 3 195 milliards en 1984 peut être estimé à près de 5 000 milliards en 1987. L'endettement du Kamerun a triplé en l'espace de 3 ans (voir tableau 4) passant de 475 milliards de F CFA à 1 400 milliards en 87 (sept.). On a trop souvent dit que les revenus pétroliers avaient permis au Kamerun un faible taux d'endettement. Si la gestion économique avait été « saine, prudente, et responsable », il n'y aurait pas dérapage de l'endettement, sauf pour promouvoir l'investissement. Ce qui ne semble pas avoir été le cas puisque les milieux du F.M.I. et de la B.M. reprochent justement à Biya de n'avoir pas comprimé les investissements à temps, lorsque les difficultés de trésorerie étaient prévisibles (dès 85). L'endettement sert en fait à compenser le manque à gagner causé par la dilapidation des fonds publics. Les bourgeoisies bureaucratiques dépensent, mais c'est le peuple qui paie, car c'est sur les recettes d'exportation, c'est-à-dire sur le fruit du travail des Kamerunais que seront prélevés les remboursements. Le service de la dette (remboursement du capital + les intérêts) était de 12 % des recettes d'exportations en 1984. Et ce n'est pas une consolation s'il est plus bas que dans la plupart des pays d'Afrique Noire. Ce serait une consolation éphémère, car il est estimé à 31 % pour 1987. De plus la dette kamerunaise qui était comme celle de beaucoup de pays africains, publique à 75 %, change de structure. Elle est de plus en plus privée et donc plus lourde à payer. Le bilan économique lamentable de la « technocratie bardée de diplômes » Si donc, le sous-développement du Kamerun résulte essentiellement :
c) des effets de la crise mondiale du capitalisme sur l'économie nationale. Quelle est alors la part de responsabilité de M. Biya et de son équipe dans la situation catastrophique du Kamerun ? C'est là une question très importante, de la réponse à laquelle dépend la façon de concevoir les perspectives de sortie de la situation actuelle. Avant d'entrer dans le détail, on peut déjà répondre en un mot que la lourde responsabilité de l'équipe Biya a été non seulement de ne pas mettre en œuvre une politique capable de contrer ces mécanismes néfastes qui ne sont pas du tout une fatalité, mais pire de s'y soumettre et même d'accentuer ceux qui dépendent du gouvernement kamerunais (les déséquilibres de gestion). Que n'a-t-on pas dit de Paul Biya quand il est arrivé au pouvoir ? Ceux qui ont regardé la télévision française à l'époque se souviendront des accents pathétiques de M. Hervé Bourges, alors PDG de la première chaîne de télévision française, vantant ce « technocrate bardé de diplômes ». De fait il fut une période où Mme Tsanga était au sein du gouvernement kamerunais la seule à ne pas être diplômée de l'enseignement supérieur. Mais elle, c'est une autre affaire. Elle avait d'autres atouts. Face au désordre économique et au mécontentement qui régnaient vers la fin de la tyrannie d'Ahidjo, les stratèges du néo-colonialisme avaient dû penser que le remplacement d'Ahidjo par des technocrates à la direction du pays permettrait une meilleure gestion économique. C'était oublier que ceux que les Kamerunais appelaient « les imboucs » – c'est-à-dire des gens peu instruits – dirigeaient le pays mais que c'était les technocrates qui faisaient marcher l'appareil d'Etat. [PAGE 237] M. Biya lui-même était déjà, depuis 1975, premier ministre chargé des questions économiques ! Il n'est donc pas étonnant de constater aujourd'hui qu'ils n'ont pas mieux réussi que leurs anciens maîtres, dits les « imboucs ». Au temps d'Ahidjo, les technocrates supportaient de moins en moins que l'appareil d'État repose sur eux, sans qu'ils bénéficient aussi des mannes de l'État détournées par la bande à Ahidjo. Leur comportement une fois arrivés au pouvoir, fait penser à celui d'un alcoolique sevré de longue date, précipité dans une grosse cuve pleine de vin. Que fait-il ? Il nage tant bien que mal pour ne pas se noyer, mais ne résiste pas à la tentation de boire, au point de devenir ivre (comme ce ministre de Biya qui, déjà saoul à 10 heures du matin, rabroue ses visiteurs). Et, affaibli par l'alcool, il sombre peu à peu... – L'équipe de M. Biya a repris les défauts de la gestion d'Ahidjo, en les aggravant considérablement, sans avoir l'excuse de l'ignorance. Ils ont dilapidé incroyablement vite les fonds de l'État. Les sommes détournées sont le plus souvent allées à des usages économiquement illogiques, anti-nationaux, ce qui a encore aggravé la crise, accéléré la récession. Les dépenses absurdes, frivoles ou de prestige, atteignent un niveau insupportable. M. Kohl, le chancelier d'Allemagne Fédérale, en a été écœuré. Pour la réception gigantesque que M. Biya lui a offerte, à l'occasion de sa récente visite officielle au Kamerun, on avait fait venir de France des containers entiers de fleurs. Réflexions de l'hôte : « Chez nous, même quand on reçoit des hôtes de marque étrangers, on n'a pas de salle aussi grande. » Après ça on ne cherchera pas une querelle d'Allemand à M. Khol, s'il refuse les crédits demandés par M. Biya qu'il a renvoyé au F.M.I. Il n'a pas envie de donner son argent à quelqu'un qui va le jeter par la fenêtre, surtout quand cette fenêtre donne sur Paris. Cette gestion biyaïste a conduit l'économie nationale au triste tableau suivant : – L'activité industrielle est en baisse, de même que l'activité commerciale, ce que reflète bien la baisse d'activité du port de Douala. La balance des paiements courants accuse un déficit de 500 millions de dollars. – La production cacaoyère baisse, en partie du fait des vieillissements des plantations qui ne bénéficient plus assez des attentions de l'État depuis l'avènement du pétrole. L'autosuffisance alimentaire tant vantée connaît de sérieuses difficultés. – L'évasion des capitaux atteint un rythme diabolique : plus de 300 milliards CFA pour la seule période de mai-juin 87. La fraude douanière ampute 50 % du trafic (70 milliards de manque à gagner). – Les liquidités des banques commerciales se sont effondrées. Le trésor public est pratiquement vide et au rythme où vont les choses, l'État sera en complète cessation de paiement à brève échéance. Il n'arrive plus à payer ses fonctionnaires, ne respecte plus ses engagements auprès du secteur privé. Sa dette interne, c'est-à-dire les sommes qu'il doit à ce secteur, dépasse 70 milliards CFA. D'où de nombreuses faillites et des licenciements massifs d'ouvriers et de cadres. Par exemple, rien que [PAGE 238] pour la ville de Douala il y a eu plus de 700 licenciements entre mars et mai 86, ce qui est beaucoup dans un pays où l'on compte en tout et pour tout 570 000 salariés[16] (en dehors du secteur rural), pour une population active de plus de 4 millions ; ce qui fait seulement 14 % de populations actives effectivement employées. La population active, c'est la population en âge de travailler (16 à 60 ans). – Dans le même temps nos avoirs extérieurs fondent à toute vitesse. L'État rapatrie les devises pour faire face à ses difficultés. C'est ainsi que 240 milliards ont été prélevés du C.H.B. en 1986. Les réserves extérieures sont tombées de 900 milliards en 85 à 400 milliards en 1986. Combien en 1987 ? La France et les pays occidentaux ne veulent pas renflouer les caisses sans l'aval du F.M.I. Ce ne sont pas les 12 milliards promis par la caisse centrale de coopération économique à Botto à Ngon, (alors ministre des finances) ni les 90 milliards promis à Biya par M. Kohl qui pourront compenser l'évasion frénétique des capitaux. Le gouvernement sera donc amené en 88 à puiser encore plus dans nos réserves extérieures, et à recourir à l'endettement. La dette publique, moins chère, n'étant plus possible sans le F.M.I., c'est, et ce sera de plus en plus la dette privée. Mais le Kamerun a perdu sa crédibilité sur le plan international. Les crédits seront donc plus chers. C'est le réflexe normal des banquiers. Ils font payer le risque. Le Kamerun récemment encore considéré comme une valeur sûre est devenu un pays à risque – à haut risque ! car il n'y a pas que le risque économique. Il y a la poudrière politique. La conséquence principale de ce triste tableau, il ne faut pas l'oublier, c'est l'aggravation du sous-développement. Déjà le budget 87/88, qui marque le début de la réalisation du 6e plan de développement a été révisé en baisse, passant de 800 à 650 milliards, ce qui signifie baisse des investissements, ralentissement de la croissance... On observe donc, et il faut le souligner, qu'alors que la gestion économique était présentée comme le point fort des technocrates bardés de diplômes, c'est précisément sur le plan économique que l'échec de M. Biya est le plus cuisant. Quelles solutions pour sortir du chaos économique ? Tout le monde dit, à droite et à gauche, que la situation ne peut plus durer. Mais il ne suffit pas de le dire pour que les choses s'améliorent. Ni le libéralisme prôné par les impérialistes, ni le plan d'austérité annoncé par M. Biya ne pourront redresser la situation. Il faut un sursaut national. – Le recours au libéralisme serait une régression. Il a été dit, à propos des sociétés d'État, tout le mal qu'il fallait penser des privatisations. La libre concurrence, c'est la loi du plus fort. Et les plus forts dans l'économie kamerunaise ce sont les étrangers, essentiellement le lobby néo-colonial de Paris. On ne s'étonnera donc pas que la France, abritée derrière le F.M.I. dont le directeur est l'ancien gouverneur de la Banque de France (l'actuel directeur de la Banque de France étant l'ancien directeur du F.M.I.), pousse au désengagement [PAGE 239] de l'Etat. Le gouvernement français, qui voit passer tous les fonds qui entrent et sortent du Kamerun, puisqu'ils doivent obligatoirement transiter par le compte d'opération du Kamerun au Trésor français pour les fonds publics ou être changés à Paris pour les autres fonds, est parfaitement au courant du montant astronomique des capitaux qui s'évadent du Kamerun. Il a laissé faire jusqu'à présent, mais de plus en plus la moutarde lui monte au nez. Les entrepreneurs français au Kamerun, victimes de l'insolvabilité de l'État, poussent le gouvernement français à agir. Premier fournisseur et 2e client du Kamerun, alors que le Kamerun n'est que le 25e client et le 38e fournisseur de la France[17], celle-ci a tout intérêt à ce que l'économie kamerunaise redémarre. Mais comment ? Les privatisations, qui sont tombées en panne en France seront-elles plus efficaces au Kamerun ?, on peut en douter. Sous la pression des USA et de la France, Biya a mis sur pied un plan de désengagement de l'État des entreprises publiques rentables sur 5 ans. Ce plan ne résoudra pas la crise. – Le recours au F.M.I. repose le même problème, car le F.M.I. exige la « libre concurrence », c'est-à-dire la liberté pour les plus faibles de disparaître. – Les mesures dites d'austérité ou de redressement, prises par M. Biya, ne réussiront pas. Ce n'est pas une prédiction, c'est une certitude. Et la raison en est simple : a) plus ça va mal et plus l'argent fout le camp. C'est-à-dire que dans les conditions d'incertitude du lendemain où sont actuellement les tenants du régime, ceux qui pillaient les caisses de l'État pillent encore plus. Ils cherchent égoïstement, au mépris de l'intérêt du pays, à se mettre, avec leur famille, « à l'abri du besoin » pour des lendemains qui ne chanteraient pas. Les détournements et la fuite des capitaux continueront donc de plus belle, sauf si une volonté politique de changement se manifestait dans le pays, c'est-à-dire s'il y a un sursaut national. b) Les Kamerunais ne consentiront pas l'effort qui leur est demandé, et n'accepteront pas l'austérité alors qu'ils voient s'étaler devant leurs yeux l'injustice sociale, le luxe insolent des nouveaux riches « à pajero », et que l'absence de démocratie bloque toute initiative individuelle. Un exemple : parmi les mesures d'austérité prises par le gouvernement figure l'alignement des salaires du secteur parapublic sur ceux des fonctionnaires. La tentative d'application de cette mesure à la SONEL (Société Nationale d'Électricité) s'est heurtée récemment à une menace de grève du personnel. Les économies de bout de chandelles préconisées par le gouvernement ne lèseront que les petits, en épargnant et même en favorisant les gros. Les missions à l'étranger continuent d'être pléthoriques comme ce fut le cas récemment à Paris pour fêter on ne sait quel anniversaire de la CAMAIR. Seul un sursaut national peut sortir le pays du chaos. [PAGE 240] Dans le contexte actuel, il y a urgence à prendre deux mesures salutaires : 1 – Faire rapatrier les fonds détournés et placés à l'étranger, pour les injecter dans l'économie nationale, tout en freinant de nouvelles évasions. Les auteurs de ces forfaits sont connus, par le gouvernement et par d'autres... Le gouvernement français les connaît tous, lui qui a renvoyé Messi comme un colis postal à Biya avec les milliards qu'il venait déposer sur le compte de son chef. Celui-ci l'a d'ailleurs implicitement reconnu, puisqu'il a reconduit Messi à la tête de la S.C.B., au grand dam du Crédit Lyonnais. 2 – Commencer enfin, sérieusement, une vraie transition vers la démocratie pluraliste qui, en favorisant une gestion démocratique, permettra d'améliorer la situation économique. B – La situation politique La situation politique n'est pas moins préoccupante que le chaos économique. Malgré des atouts inestimables au moment de sa prise de pouvoir, M. Biya n'a pas su défaire le nœud politique kamerunais. Des atouts gâchés M. Biya a bénéficié après son accession au pouvoir d'un large soutien auquel aucun chef d'État en Afrique n'a jamais pu prétendre. Il avait le soutien d'un peuple débarrassé de son tyran et qui manifestait son enthousiasme dans les rues. Il avait le soutien des milieux d'affaires, qui lui ont adressé une motion de soutien. Il avait le soutien de l'armée, qui l'a montré de façon spectaculaire, mais malheureusement dramatique en avril 1984, en le sauvant de la tentative de renversement par la bande criminelle d'Ahidjo. Il avait le soutien de l'U.P.C. jusqu'en 1984 lorsque le 4e congrès, constatant qu'il tournait le dos aux intérêts populaires, le lui retira sans pour autant manifester une hostilité tous azimuts. En janvier 84 elle appela à voter contre lui à l'élection présidentielle, mais c'est en 1985, après le congrès de l'U.N.C./R.P.D.C. à Bamenda que l'U.P.C. appela ouvertement à combattre le R.D.P.C. Elle continua cependant à reconnaître lorsqu'il y en avait, les actes positifs du régime, comme par exemple en août 1986 quand, par un télégramme signé de l'auteur de ces lignes, l'U.P.C. prit acte positivement de la libération de prisonniers politiques et encouragea le président à continuer jusqu'à vider les prisons. La seule fausse note dans ce tableau fût l'attitude de la France, qui jouait un jeu trouble. La « cohabitation » en France était en gestation. [PAGE 241] Les premiers contacts de l'U.P.C. avec Paul Biya[18] firent craindre à M. Mitterrand que l'avalanche qu'il venait de déclencher avec la démission d'Ahmadou Ahidjo n'emportât la montagne. Tout en soutenant officiellement le gouvernement de M. Biya, la France continua de trafiquer avec l'ex-tyran considéré comme le meilleur anti-dote à l'U.P.C. C'est le « Figaro », reflet du lobby néo-colonial de Paris, qui exprime le mieux cette conception dans son édition du 14 février 1983 sous la plume de Yves Bréhéret : « Hors de l'U.N.C., bien sûr, pas de fonction au gouvernement. Mais un nouveau danger se dessine : ce sont ils efforts de l'U.P.C., parti interdit par les autorités coloniales françaises, pour revoir le jour au Cameroun. Ce mouvement, fondé en 1948 par le syndicalo-marxiste Um Nyobé, engagé dans la lutte contre Ahidjo jusqu'en 1970, relève aujourd'hui la tête. Il vient d'ailleurs de tenir une conférence de presse à Paris et réclame – selon la constitution – son droit à la libre expression. Monsieur Ahidjo devra, là encore, intervenir en lieu et place de M. Paul Biya contre Woungly Massaga, le leader de l'U.P.C. » Dans les milieux proches du Parti Socialiste, au contraire, on ne tarissait pas d'éloges pour le nouveau président, tout au moins au début. Tenant compte de ces avis contradictoires, et des incertitudes du bicéphalisme qui avait alors cours au Kamerun, le maître d'œuvre de la future cohabitation cultivait l'ambiguïté jusqu'à ce que l'échec de la tentative de putsch d'Ahidjo le 6 avril 1984 le contraignit à prendre plus ouvertement parti pour un camp contre l'autre. Sans cependant abandonner Ahidjo, dont la tentative de putsch avait bénéficié du soutien de la France. C'est par des épisodes sanglants de ce genre que la France se manifeste périodiquement au souvenir du peuple kamerunais. Il ne faut pas que celui-ci perde la mémoire. Avec des atouts aussi importants entre les mains, M. Biya a raté son entrée dans l'histoire. Il aurait pu devenir l'homme que l'histoire allait retenir comme celui qui a levé le blocage qui handicapait la vie politique nationale. Manquant totalement de sens politique, il a mécontenté les unes après les autres toutes les catégories sociales qui l'avaient soutenu. Les upécistes sont bien placés pour percevoir le phénomène du mécontentement grandissant contre le régime, surtout au début, quand il était moins flagrant que maintenant. En effet, comme pendant la tyrannie d'Ahidjo, l'U.P.C. était la seule pendant longtemps, à critiquer les actes négatifs du gouvernement, tandis que beaucoup de Kamerunais se contentaient de véhiculer la propagande insidieuse du régime, dont les thèmes étaient bien connus : « ce n'est pas lui, c'est l'autre », « il ne fait que terminer le mandat de l'autre; il faut attendre son propre mandat pour le juger », ou encore : « c'est un intellectuel, il va changer les choses, mais il faut lui laisser le temps... ». « il vient seulement d'arriver [PAGE 242] au pouvoir... », « lui-même est bon, c'est son entourage qui est mauvais » etc. et toutes sortes de boniments de ce genre. A partir des derniers mois de 1983, plus exactement du 14.9.83, quand le congrès extraordinaire de l'U.N.C. porta M. Biya à la tête de ce parti, et que l'U.P.C. commença à lui retirer son soutien, nos critiques contre les actes du gouvernement rencontraient toutes sortes de réaction : approbation, scepticisme, désintérêt, voire hostilité de certains compatriotes. Ces réactions négatives sont aujourd'hui beaucoup plus rares, et en dehors des cercles des nouveaux riches à « pajero », il est bien difficile de trouver aujourd'hui un défenseur du régime de Biya, et ceci même au sein du R.D.P.C. Les milieux populaires furent les premiers mécontents : « le peuple s'est retourné contre Biya dès qu'il est apparu qu'il ne parlait du renouveau, de la rigueur et de la moralisation que du bout des lèvres. Ses portraits officiels furent déchirés pendant la campagne électorale pour les présidentielles de janvier 1984. A Douala et dans certaines villes du Nord, l'armée a dû protéger ces portraits de la colère populaire. Les étudiants sont redescendus dans la rue contre Biya peu après être descendus pour le soutenir. Des émeutes eurent lieu à Bamenda où les populations s'attaquèrent aux policiers qui avaient tué un des leurs sans raison. Des grèves se sont multipliées vers la fin de 1983. Notamment à Douala. Les journalistes et les intellectuels commencèrent à faire l'objet d'une répression systématique, alors que par ailleurs M. Biya prétendait contre toute évidence, qu'il n'était plus « nécessaire de prendre le maquis ou de s'exiler pour exprimer ses opinions ». Maurice Kamto est arrêté pour sa critique du livre de Mono Ndjana « L'idée sociale chez Paul Biya », livre qui chante les louanges du président. Avant cela, en mai 1984, cinq journalistes du « Cameroun Times » de Limbé avaient été arrêtés pour avoir critiqué la gestion du pactole pétrolier. Vincent Nchami, Bonu Muchongong, Charles Ndi Nchia, Peter Adi Fonte, Stephen Mugwa Tebid furent déportés à Yaoundé. Puis en mars de l'année suivante le rédacteur en chef du même journal, Paul Nkemayang, est arrêté pour avoir dénoncé le scandale du trafic pétrolier à la SONARA. Pius Njawe, le rédacteur en chef du journal « Le Messager », sera également arrêté. La liste des journalistes victimes de la répression est longue; on la trouvera dans une brochure du CDAPPC[19] et dans le No 3 du « Cameroon Monitor »[20] pour la période de 1982 à 1986. Pour l'année 1987, le clou de la répression anti-intellectuelle et anti-journalistes fut incontestablement la rafle qui suivit le débat organisé le 11.3.87 à l'université sur le thème de « la littérature politique au Cameroun ». Beaucoup d'intervenants qui avaient émis des idées contraires à celle de Mono Ndjana, de même que les journalistes qui avaient rendu compte [PAGE 243] du débat dans la presse sans faire la part belle à Mono Ndjana, furent arrêtés. En répondant par la force de la baïonnette à ses contradictions dans un débat d'idées, l'auteur de « l'ethnofascisme » a tout simplement recouru à des méthodes fascistes. Qui osera prétendre que Mono Ndjana n'est pour rien dans ces arrestations ? En réalité l'événement à propos de ce débat, ce n'est pas tant le débat lui-même, ni les arrestations qui l'ont suivi, que surtout la lettre ouverte des intellectuels (de quelques intellectuels seulement, malheureusement) adressée au Président de la République pour demander la libération de ceux qui étaient arbitrairement détenus à cause de ce débat. Pourquoi est-ce un événement ? Parce que les intellectuels kamerunais pour la plupart sont habitués à courber l'échine. Il y avait eu la lettre courageuse de René Philombe à Paul Biya en 1984 pour proposer une solution au problème national. Mais c'est la première fois que des intellectuels kamerunais vivant et travaillant au Kamerun adoptent publiquement et collectivement une position aussi courageuse. C'est là un motif d'optimisme pour l'avenir de notre pays. Une autre remarque intéressante est que pour la première fois aussi, le régime porte la répression dans son propre camp, en arrêtant les journalistes des médias officiels que sont les Ndatchi Tagne, Martin Sua Ntyam, Jean-Marie Nzékoué, Ebona Nyetam. La même remarque vaut encore plus pour les dirigeants de « Cameroon Tribune », Jean Mboudou, Zambou Zoleko et Jean-Luc Kouamou, arrêtés pour une toute autre affaire : la publication d'un décret présidentiel pourtant authentiquement signé. En fin de compte, on peut dire qu'aujourd'hui, en dehors des idéologues « mono-ndjaneux », il est bien peu d'intellectuels qui défendent le régime de M. Biya. Les hommes d'affaires ne trouvent plus leur compte dans le système Biya. Ils sont délaissés au profit d'individus étrangers aux affaires dans l'attribution des crédits et des marchés de l'Etat. Et pour mieux les asphyxier, l'État ne respecte plus ses engagements et n'honore plus ses contrats. Certains attendent toujours les paiements annoncés par le président lors de sa visite à Douala. Ils en ont assez de payer des pots de vin exorbitants aux technocrates, de se faire rançonner par les agents des impôts, de la douane ou de la police, sans voir les retombées financières qu'ils attendent de ces corruptions. Et pour couronner le tout, on les désigne comme bouc émissaire responsables de la faillite des banques. On est loin de la motion de soutien à Paul Biya... Le régime a trouvé le moyen de mécontenter même les officiers supérieurs. Sous toutes les dictatures, ces officiers, généraux et autres gradés, sont aux petits oignons; les dictateurs font tout pour qu'il ne leur manque rien, et le mécontentement dans les armées se limite souvent aux soldats du rang et aux sous-officiers. M. Biya, lui, il se croit très fort. Il brime même les généraux, dans un pays où il n'y en a que quatre en tout et pour tout. Des soldats ont été envoyés pour perquisitionner chez le général Ngariso à son insu. Le colonel Asso, qui se promène dans tout Yaoundé avec les clés de la poudrière pour bien [PAGE 244] montrer que c'est « eux » qui ont le pouvoir, insulte ouvertement des officiers plus gradés que lui et le général Semengué, le chef d'état-major des armées, ne fait rien. Des valeureux officiers qui ont défendu le régime au risque de leur vie en avril 84, contre la bande à Ahidjo, alors que certains officiers supérieurs se terraient comme des rats après les premiers coups de feu, sont traités comme des malpropres, écartés des nominations, voire suspectés. On a exécuté à la sauvette, après le malheureux coup d'avril 84, des officiers, des soldats, dont la culpabilité n'était pas clairement établie, et dont certains, comble d'injustice, avaient été du côté des loyalistes pour sauver M. Biya ! Devant la chasse aux sorcières dans l'armée après le coup de 84, bien des militaires ont pris la fuite. Où sont-ils ? Que font-ils ? N'est-ce pas inquiétant pour un gouvernement ? Pour se rassurer, M. Biya a fait appel aux Israëliens pour assurer sa garde personnelle. C'est retourner le couteau dans la plaie. Cette méfiance ouvertement manifestée n'est-elle pas une insulte supplémentaire à nos soldats ? Ainsi M. Biya a vu se rétrécir progressivement sa base sociale, jusqu'à n'être plus qu'un colosse aux pieds d'argile. Que sont devenues les promesses d'antan ? Aucun des engagements pris par M. Biya devant l'opinion depuis son accession au pouvoir n'a été tenu. Que ça soit au sujet de la liberté d'expression, au sujet du retour des exilés politiques, ou au sujet de la démocratisation. Sa déclaration au congrès de la transmutation de l'U.N.C. en R.D.P.C. à Bamenda, selon laquelle « il n'est plus besoin de prendre le maquis ou de s'exiler pour exprimer ses opinions » n'était qu'un thème de propagande. On a vu ce qu'il fait de la liberté d'expression. Ce n'est pas à lui qu'on doit la création de nombreux nouveaux journaux qu'on peut observer depuis 1982, ni la parution de nombreux livres d'auteurs kamerunais. Un certain nombre de titres dans la presse sont de pures créations du pouvoir ou sont manipulés en sous-mains par ses hommes de main. En réalité, la floraison de titres de presse au Kamerun depuis 1982 traduit plus une poussée de l'opinion qui se bat pour s'exprimer qu'une libéralisation du régime, et ça c'est l'acquis principal du peuple kamerunais après le départ d'Ahidjo. La preuve c'est que les journaux sont censurés quotidiennement et paraissent avec des colonnes voire des pages blanches; c'est que les journalistes sont réprimés, intimidés, comme si on voulait les pousser à l'auto-censure. Quant aux livres, il est significatif que la plupart soient édités à l'étranger. Les arrestations sans inculpation et les détentions sans jugement continuent comme par le passé. Elles ne concernent pas seulement les upécistes. Si la vague d'arrestations qui a déferlé à la fin de 1985 a frappé surtout dans leurs rangs, parmi les sympathisants et les lecteurs de « La Voix du Kamerun », faisant plus de 300 victimes, les descentes de police opérées depuis lors ont concerné divers secteurs. C'est dire si en matière de répression biyaïste tous les Kamerunais sont menacés. [PAGE 245] La déclaration du président sur le perron de l'Élysée, le 15 février 1983, ne pouvait pas être comprise autrement que comme un accord au retour des exilés politiques. En voici le texte tel qu'il figure dans « Cameroun Tribune » du 16.2.83 : « L'U.P.C. en tant que telle n'a aucune existence légale au Cameroun. Mais je sais qu'il y a des Camerounais qui se réclament de cette appellation, dont certains se trouvent en France. Mais je dis que s'ils veulent rentrer au Cameroun ils peuvent le faire. » On sait maintenant que c'était là aussi des propos démagogiques. Bien peu de Kamerunais savent que le 14 juin 1983, quatre mois donc après cette déclaration, et après que les upécistes aient écrit au président et à l'ambassadeur en France pour demander leur rapatriement, celui-ci fit appel à la police française pour chasser de leur ambassade, c'est-à-dire d'une parcelle du sol national, les upécistes venus demander leurs passeports pour rentrer. M. Bakoto, alors en poste à Paris, était en liaison permanente avec le palais d'Etoudi durant toute la durée de la présence upéciste devant l'ambassade. On ne pourra donc pas prétendre que M. Bakoto ait agi de son propre chef. L'auteur de ces lignes était présent et se souvient très bien de sa conversation avec le commissaire de police du 16e arrondissement de Paris qui commandait l'opération et qui indiquait clairement qu'il avait reçu des ordres pour ne pas nous laisser entrer. On saura par la suite que M. Bakoto avait justifié sa requête de la police par la peur d'un commando terroriste ! C'était imaginer un commando terroriste masochiste indiquant avec précision l'heure et le jour et l'endroit où il va frapper ! rocambolesque n'est-ce pas ? Nous avions en effet écrit à l'ambassadeur pour lui annoncer notre arrivée et solliciter une audience. Depuis cet épisode, M. Biya a multiplié les obstacles au retour des upécistes, et le fait que le seul dirigeant upéciste qui a demandé à rentrer et qui est effectivement rentré – avec l'accord explicite et même l'appui du président – soit aujourd'hui déporté au bagne de Tcholliré, n'est pas une indication que les upécistes peuvent effectivement rentrer, vivre et travailler dans leur pays comme tout citoyen ! C'est ce qui est arrivé à Zézé Samuel. M. Biya ne veut pas d'upéciste au Kamerun, même mort. Après Le décès brutal de notre camarade Emock Elang Thomas dit Costa à Luanda le 12.8.86, l'U.P.C. a adressé au président Biya le télégramme suivant :
PRESID B 8 595. Excellence,
J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation de
rapatriement à Ndikinimeki, sa ville natale, de la dépouille
mortelle de Emock Elang Thomas, vétéran de la lutte pour
l'indépendance et le progrès du pays, décédé
le 12.8.86 à Luanda. Siméon Kuissu [PAGE 246] Ce télégramme resta sans réponse malgré les démarches auprès de l'ambassadeur. On pouvait penser que le respect pour l'âge sinon pour les sacrifices héroïques de ce militant de la première heure des quartiers de Douala soumis au feu des colonialistes français, aiderait à faire passer les considérations humanitaires avant toute autre considération, pour permettre à Emock Thomas de reposer en paix parmi les siens. Il n'en fut rien. On peut tout enlever aux upécistes si l'on en a envie; mais on ne peut pas leur enlever la stature que leur confèrent les sacrifices qu'ils ont consentis par le passé et consentent encore aujourd'hui pour leur pays. C'est pourquoi il est particulièrement injuste et immoral non seulement d'avoir gracié Ahidjo comme Biya l'a fait, mais surtout de vouloir lui accorder ce qu'il refuse aux upécistes exilés : le retour au Kamerun. En effet, lors de son voyage en France en mai 87, le président, répondant à la question d'un journaliste, a dit : « Si Ahidjo veut rentrer au Kamerun, il doit faire un geste ». De quel geste s'agit-il ? Les upécistes n'ont-ils pas fait assez de gestes depuis cinq ans ? L'écrivain patriote R. Philombe dans une lettre courageuse à M. Biya en 1984, avait souligné cette injustice. Le président ne l'a pas entendu. La démocratisation est l'autre promesse que le successeur d'Ahidjo avait faite au pays. Elle a connu le même sort que les autres, malgré une succession de décrets scélérats modifiant les lois électorales pour les présidentielles, les municipales et les législatives, et malgré tout le tapage orchestré autour de la prétendue multiplicité des candidatures pour les élections internes au R.D.P.C. et pour les récentes élections municipales. Le président traite les citoyens comme des demeurés en leur racontant sa fameuse table des 200 ethnies qui seraient un obstacle au pluralisme politique. Il s'enferme dans la contradiction en s'opposant au multipartisme tout en maintenant l'article 3 de la consitution qui le prévoit clairement. En guise de démocratie, il nous offre le spectacle pitoyable des élections truquées. Élection présidentielle de janvier 1984. Élection au sein du R.D.P.C. en 1986. Élections municipales en octobre 1987. La justification officielle des élections présidentielles de janvier 84 avait été de conférer au président une légitimité populaire; de lui donner enfin, semble-t-il, le pouvoir qui lui était nécessaire pour engager les réformes, ce qui, constitutionnellement, est faux. La constitution donnait déjà tous les pouvoirs à M. Biya, qui ne pouvait en avoir plus après l'élection du 14 janvier 84. La vraie raison de l'organisation précipitée de cette élection est la suivante : après le deuxième congrès extraordinaire de l'U.N.C. le 14 septembre 83, congrès qui porta Biya à la tête de ce parti haï des Kamerunais, alors que rien ne l'obligeait à accepter cette présidence, il s'est rendu compte que sa popularité commençait à baisser. Alors il a conçu le projet de se faire élire président de la République à la sauvette, à la faveur d'une élection présidentielle anticipée permise par une nouvelle manipulation constitutionnelle portant sur l'article 7, pour ne pas courir le risque d'un affrontement électoral difficile en 1985 lorsqu'il serait encore plus impopulaire, et qu'il aurait à faire face à la fois aux barons d'Ahidjo et à [PAGE 247] l'U.P.C. dont aucune revendication n'était satisfaite. Une fois « élu », M. Biya se livra à nouveau à une manipulation de l'article 7 pour supprimer tout risque de compétition contre lui en supprimant le poste de premier ministre et en faisant de Salomon Tandeng Muna le président par intérim en cas de vacance de la présidence, chargé d'organiser de nouvelles élections présidentielles sans avoir le droit de se porter candidat. Pauvre Muna. Quand arrêtera-t-il de manger des carottes ? En 1966 Ahidjo lui en avait tendu une pour l'amener à accepter le parti unique. Maintenant Biya lui en fourre une dans la bouche pour qu'il accepte la sale besogne de continuer à calmer les « westerners » très mécontents à juste titre du régime. La constitution aura décidément rendu beaucoup de services à M. Biya : – l'article 7 lui a permi d'accéder à la magistrature suprême un peu comme un billet de loterie qui fait gagner le gros lot. L'article 5 lui a permis d'avoir raison de l'adversaire-tuteur-prédécesseur, dans leur conflit sur la primauté du parti et de l'État. Une nouvelle manipulation de l'article 7 lui a permis de se faire « plébisciter » en janvier 84 et une remanipulation du même article après son a élection » lui évite de futurs concurrents. Et l'article 3 alors ? à quand son application, ou sa manipulation? Les élections à la base du R.D.P.C. n'avaient aucun sens dans la mesure où la direction de ce parti qui commande tout, n'avait pas été elle-même élue. En effet, au congrès de Bantenda Senga Kuo était tout simplement monté à la tribune et avait lu une liste de personnes qui sont ainsi devenues membres du Comité Central du R.D.P.C. ! Plus intéressantes à considérer sont les élections municipales récentes – octobre 87 –. Elles ont permis d'ouvrir les yeux des membres du R.D.P.C. qui se faisaient encore des illusions sur la possibilité de démocratiser ce parti. En effet les jeux étaient faits d'avance : a) La sélection par l'argent (50 000 CFA par candidat sur la liste) excluait de la compétition les milieux populaires, c'est-à-dire l'immense majorité des Kamerunais. b) Dans la majorité des villes, la loi prévoit que les maires seront toujours nommés par le gouvernement comme du temps d'Ahidjo. c) Mais la principale escroquerie (c'est une escroquerie parce que cela n'avait pas été dit à l'avance) c'est que les maires d'arrondissement (dans les grandes villes) et les maires des petites communes ne seront pas ceux que les électeurs auront élus comme tête de liste, mais un des conseillera nommés par le gouvernement. M. Abondo a prétendu, après les élections, que la tête de liste était simplement le premier nom sur la liste dans l'ordre alphabétique ! C'est ainsi que M. Ekindi, qui se voyait déjà maire du 1er arrondissement de Douala, et même raconte-t-on, futur président de la République, s'est retrouvé le bec dans l'eau. L'expression des électeurs est vidée de son sens après coup. De toute façon ces maires d'arrondissement n'ont pour ainsi dire aucun pouvoir. Tout est décidé par le délégué du gouvernement. d) La fraude était multiforme : inscription sélective sur les [PAGE 248] listes électorales, distribution sélective des cartes d'électeurs; (privant certains milieux comme l'université), vol de cartes d'électeurs, fermeture de certains bureaux de vote alors que de nombreux électeurs faisaient encore la queue pour voter, suppression des bulletins de certains candidats dans certains bureaux de vote, arrestations, bourrage des urnes, etc. Enfin, il faut ramener ces « élections » à leur juste proportion en précisant que, même si elles s'étaient déroulées de manière régulière, il n'en demeurerait pas moins que pour être candidat, il fallait être membre du R.D.P.C., seul « parti légal » (sic). Les millions de Kamerunais – la majorité – qui ne sont ni membres ni même seulement sympathisants de ce parti, se voient ainsi privés de leur droit de citoyens. Drôle d'État de droit ! Dans ces conditions, force est de constater la maturité politique du peuple kamerunais, qui a fort bien compris que ces élections étaient un coup d'épée dans l'eau, et s'est abstenu à 70 % – chiffre officiel ! – c'est la donnée politique essentielle de ce scrutin. Il est à prévoir que les élections législatives qui devraient avoir lieu en 1988 se dérouleront de la même manière. Quant aux présidentielles de 89, nul ne peut affirmer qu'elles auront même lieu. La faillite politique des technocrates « bardés de diplômes » La faillite politique de ceux dont beaucoup attendait qu'ils gèrent mieux le pays, est ainsi évidente. Elle s'est produite à une vitesse vertigineuse. L'U.P.C. avait bien dit que le peuple kamerunais ne supporterait pas à nouveau 25 ans de dictature. Au lieu de prendre les décisions courageuses qui seules peuvent le sauver et redresser le pays, c'est-à-dire une réelle ouverture politique, M. Biya et son équipe font preuve d'une indécision politique exceptionnelle, s'agitent dans le désordre et s'enfoncent davantage, tel un homme pris dans les sables mouvants, et ce n'est pas la Rose-Croix qui les sauvera. Cette officine impérialiste ne peut remplacer la base sociale que Biya a perdue. Quelle peut bien être la longévité d'un régime qui a perdu le soutien du peuple, des milieux d'affaires, de beaucoup d'intellectuels, et qui titille maladroitement son armée comme un polisson imprudent titillerait une ruche ? Des lézardes sont de plus en plus apparentes au sein du gouvernement. Bien que Owona et Oyono, qui ne cohabitent plus au palais, aient cessé de se donner en spectacle dans les arènes d'Etoudi, leur désaccord n'en persiste pas moins. C'est encore le même Owona que l'on retrouve contre Nkuete dans l'affaire du décret présidentiel signé mais qu'il ne fallait pas publier (!). Est-ce que Owona espérait encore faire changer d'avis à Biya ? En réalité, l'inauguration au Kamerun de la fonction hybride de secrétaire général du gouvernement, présentée comme une simple réforme administrative, a mis en lumière une crise politique. La division artificielle des pouvoirs entre un directeur du cabinet présidentiel qui serait [PAGE 249] chargé de fonctions politiques et un secrétaire général du gouvernement qui n'aurait qu'une fonction administrative, l'affaire de la publication « prématurée » du décret présidentiel fixant les attributions de Jean Nkuete, secrétaire général du gouvernement, la démission camouflée en limogeage de M. Eteki Mboumoua, son autant de manifestations de tensions internes qui s'inscrivent dans la continuation de la crise du régime du parti unique qui dure depuis plusieurs années maintenant. M. Mengueme ne rate pas une occasion de dire que Biya l'embête avec ces histoires de démocratisation, et se présente comme l'ennemi juré de l'U.P.C. Ce n'est pas pour rien qu'il était un des barons d'Ahidjo. M. Sengat Kuo secrétaire politique du R.D.P.C., qui a disparu bizarrement de la scène politique, essaie semble-t-il de faire revivre ce parti. Mais le R.D.P.C. ne peut pas être ranimé. Il n'y a plus assez d'argent pour acheter les clientèles. Car, et c'est à peine nécessaire de le redire, les gens n'adhèrent pas au R.D.P.C. pour défendre des idées, pour participer à une réflexion et à la mise en œuvre d'une politique définie mais pour rechercher des privilèges, des avantages, des prébendes. C'est pourquoi on peut dire que l'U.N.C./R.D.P.C. n'est pas un parti politique, mais une structure de pouvoir qui ne vit que grâce à l'appareil d'État. C'est tout le contraire de l'U.P.C. qui ne vit que grâce aux sacrifices de ses militants. L'échec de la petite bourgeoisie technocratique était pourtant prévisible : formés vers la fin de l'ère coloniale et au début de la période néo-coloniale ces technocrates fanfarons ont petit à petit occupé les rouages de l'Etat et sont devenus la cheville ouvrière du système Ahidjo. C'était des espèces d'abeilles ouvrières constamment à l'ouvrage mais laissant les honneurs du pouvoir aux faux bourdons de la féodalité et à la reine abeille : M. Ahidjo. Leur influence grandissant dans les diverses clientèles politiques des féodaux et de la grande bourgeoisie, ils ont fini par être représentés dans les centres du pouvoir notamment au Comité Central et au Bureau Politique de l'U.N.C. Mais ils ont supporté sans broncher 25 ans de dictature pendant que les forces révolutionnaires regroupées au sein de M.P.C. payaient un lourd tribut à la lutte contre l'absolutisme. Cette lutte a créé les conditions socio-politiques leur permettant enfin de faire preuve d'un peu plus de détermination : ils disent et écrivent aujourd'hui, au sujet du régime Ahidjo, ce que l'U.P.C. dit et écrit depuis 25 ans. C'est cette bourgeoisie technocratique qui assume le pouvoir au Kamerun, surtout depuis le 18 juin 1983. Exécutants plus que décideurs, elle assure très mal cette charge, parce qu'elle est handicapée par trois tares congénitales; son inorganisation, sa couardise, son mépris et sa peur des masses populaires. N'ayant pas de parti véritable, elle n'a même pas d'idéologues dignes de ce nom. En guise de penseurs, elle ne dispose que d'intellectuels-griots, timorés et malhonnêtes, qui ne savent que chanter les louanges du plus fort du moment. Et avec ça, la modestie ne les étouffe pas; ils ont la prétention de faire croire, et même d'écrire que tous les intellectuels kamerunais sont comme eux, qu'ils ont courbé l'échine pendant [PAGE 250] les 25 ans de la dictature d'Ahidjo (Jean-Pierre Fogui dans Cameroun Tribune Spécial nov. 82 - nov. 83) qui avait « inhibé » presque entièrement leurs capacités créatrices, leur audace prométhéenne (sic) !! La couardise de l'équipe de Biya (si équipe il y a) est absolument légendaire. Il avait fallu que la colère de ses partisans devienne menaçante et que l'on attente à sa vie, pour que M. Biya se décide enfin à porter un coup au clan Ahidjo par le remaniement ministériel du 18 juin 1983. Plus récemment on a vu M. Biya se réfugier en Suisse pendant les procès de février 1984, procès qui traduisaient en fait sa réaction à l'échec de sa tentative de réconciliation avec Ahidjo. Le pouvoir était informé de l'imminence d'un coup d'État avant le 6 avril 1984. Au lieu de prendre des mesures de sauvegarde nationale, les responsables de l'État ont plutôt essayé de sauver leur peau. Le 5 avril 1984, la veille de la tentative de putsch, il était impossible de joindre un haut responsable à Yaoundé. Ils étaient tous planqués. Le mépris et la méfiance à l'égard des masses populaires se traduit dans l'apologie des diplômes et le culte de l'élitisme, alors que la preuve est loin d'être faite que les citoyens « bardés de diplômes » comprennent mieux la politique que les autres. C'est plutôt le contraire qui est en train d'être démontré sous nos yeux, puisque le gouvernement de M. Biya, composé presque entièrement de diplômés de l'enseignement supérieur, s'avère de plus en plus incapable de gouverner le Kamerun. Si les partisans de M. Biya s'étaient regroupés dans un parti à eux, le parti du président, en dehors de l'U.N.C., le Kamerun se serait trouvé de fait dans une situation de multipartisme. Dès lors, il n'y aurait plus eu d'argument pour continuer à refuser la légalité de l'U.P.C. L'U.P.C. légale, cela voulait dire enfin l'intervention ouverte des masses laborieuses et des intellectuels révolutionnaires dont l'U.P.C. capitalise et exprime les aspirations, dans la vie politique nationale. C'est précisément ce que M. Biya n'a pas voulu. « Faire quelque chose » pour les masses, les petits bourgeois opportunistes peuvent l'essayer. Laisser les travailleurs prendre en mains leurs propres affaires, et intervenir dans la gestion du pays dont ils produisent les richesses, non ! C'est cette méfiance à l'égard des masses qui explique l'hostilité grandissante de l'équipe Biya pour l'U.P.C. L'agitation sociale a connu trois temps forts en 1987 : le soulèvement des prisonniers à Douala, la grève des chauffeurs de taxis et la manifestation des étudiants de l'université de Yaoundé en décembre 87. La grève des taximans après qu'un des leurs ait été assassiné par un policier marque leur refus de continuer à se laisser rançonner par les agents de police à longueur de journée. Le gouverneur de la Province de Littoral a cédé à leurs injonctions et c'est signe que la lutte dans l'unité paie. La révolte des étudiants avait pour objet de revendiquer le paiement de leurs maigres bourses de 30 000 CFA par mois, en retard de plusieurs mois et l'amélioration de leurs conditions de vie et d'étude. La réponse du gouvernement fut une répression extrêmement brutale. Des [PAGE 251] rumeurs non confirmées font état d'un mort, de plus de 300 arrestations, et de nombreux étudiants en fuite. La répression n'ayant pas fait céder les étudiants, le gouvernement est revenu à la charge par d'autres moyens. Le président de la République lui-même est monté au créneau, comme on dit, pour tenter d'abuser les étudiants. Il a dit avoir donné des instructions pour que les bourses soient payées, et il a prétendu que le retard de leur paiement était dû à des lenteurs administratives, qu'il a promis de sanctionner. Seulement voilà : on sait que les autorités compétentes, au niveau qui convient, avaient adressé au président, en temps opportun, des rapports attirant l'attention sur la gravité de la situation à l'université ! Si lenteurs il y a, c'est au palais d'Etoudi qu'il faut les rechercher, et c'est même peut-être au sommet de l'État qu'elles se trouvent. M. Biya ira-t-il jusqu'à s'auto-sanctionner ? De toute façon les lenteurs administratives, en l'occurrence tout au moins, ne sont pas en cause. Le fond du problème est que les technocrates « bardés de diplômes » ont « bouffé » tout l'argent de l'État et qu'il n'en reste pas plus pour payer les fonctionnaires que pour payer les bourses aux étudiants. Les mots d'ordre avancés par les étudiants demandaient, entre autres, la démission de Biya, ou proposaient à son épouse de vendre quelques-uns de ses bijoux pour payer leurs bourses. Si ces étudiants savaient qu'en un seul mois il s'est évadé 300 milliards CFA du Kamerun, en mai dernier, c'est-à-dire de quoi payer 80 000 bourses, de 30 000/mois pendant 10 ans... Un mot d'ordre retient spécialement l'attention par sa signification : la revendication du retour d'Ahidjo. Cette revendication donne la mesure de la régression sociale qui s'est effectuée sous le gouvernement de Biya. Ce n'est pas le régime d'Ahidjo qui était bon. C'est le régime de Biya qui est mauvais, très mauvais. On peut rapprocher cette revendication des étudiants de celle de certains paysans africains regrettant le temps colonial; ce qui est la traduction de ce que les économistes décrivent fort bien : l'aggravation du sous-développement. La solution à la situation actuelle n'est pas de revenir en arrière, mais d'aller de l'avant. Seulement il faut lutter pour aller de l'avant, alors que c'est si facile de s'arrêter ou de reculer. Le retour d'Ahidjo ne demande aucun effort des Kamerunais. Il suffit de se coucher et il viendra nous marcher dessus comme il l'a fait pendant 25 ans. Alors que aller de l'avant dans la situation actuelle signifie aller vers la démocratie, vers plus de participation des citoyens à la marche du pays, de la cité, de l'entreprise, de l'université : c'est-à-dire plus de travail, plus d'effort. En réalité, demander le retour d'Ahidjo est une solution de facilité, de résignation. Le détournement des fonds destinés aux sinistrés du lac Nyos : une importante question morale Jean Marcel Mengueme, ancien ministre d'Ahidjo et de Biya, était président de la commission nationale chargée de gérer les fonds d'aide [PAGE 252] aux sinistrés du lac Nyos lorsqu'il était ministre de l'administration territoriale. Il a été limogé au cours d'un remaniement ministériel. Deux questions se posent : 1) est-il parti avec les fonds ? Si oui qu'attend le gouvernement pour les récupérer, et pour le sanctionner. 2) S'il les a laissés dans les caisses publiques, qu'attend le gouvernement pour les mettre à la disposition des sinistrés qui vivent dans des conditions inhumaines, parqués dans des camps de fortune, sans avoir l'autorisation de retourner sur leurs terres ? Ce qui est en jeu ici, c'est moins la confiance du peuple aux dirigeants dont les Kamerunais savent depuis longtemps qu'ils sont corrompus, que surtout la crédibilité et l'honneur de notre pays devant le monde, et surtout devant les généreux donateurs ! Aurons-nous encore le toupet d'appeler à l'aide si une nouvelle catastrophe se produisait ? Assurément, « en mettant du vin nouveau dans de vieilles outres on risque de le perdre », même « si la jeunesse n'est pas obligatoirement un critère de compétence ». Que dit M. Abondo qui a remplacé M. Mengueme au ministère et à la tête de la commission ? C – Le Kamerun a les capacités pour sortir de la crise économique et politique. Mais il faut une autre politique pour cela. L'échec de M. Biya et de son équipe illustre l'impossibilité de poursuivre encore la dictature du parti unique néo-colonial au Kamerun. En ce moment où toutes les parties concernées par la situation kamerunaise se posent le problème de l'après-Biya, il importe de souligner avec force un certain nombre de considérations qui ne sauraient être contournées si on veut aborder avec honnêteté et efficacité la question du changement au Kamerun. Ces considérations sont au nombre de trois :
b) La démocratie est ce que veut le peuple kamerunais. c) Le changement démocratique ne tombera pas du ciel. Il sera l'œuvre des Kamerunais qui doivent s'unir pour cela. La question à l'ordre du jour est bien celle du changement démocratique et non d'un simple changement d'hommes. Il est clair que les causes de la situation actuelle ne résident pas seulement dans l'incompétence de M. Biya, dans la couardise, l'opportunisme et le larbinisme de ceux qui l'entourent. Ces causes remontent de loin et sont fondamentalement les mêmes qui ont poussé Ahidjo à l'échec, même si cet échec fut camouflé sous diverses façades parfois hideuses. C 1 – Le système de parti unique néo-colonial a fait faillite. Après l'échec d'Ahidjo qui a tout essayé pour maintenir son pouvoir pendant [PAGE 253] 25 ans, après l'échec encore plus rapide de Biya qui a repris les méthodes d'Ahidjo, cette faillite en maintenant bien évidente. Les querelles entre Biya et Ahidjo au cours de la 1re moitié de 1983 auraient pu avoir raison du parti unique. Après le coup de force de Biya contre Ahidjo – c'est-à-dire le fameux remaniement ministériel du 18 juin 1983 par lequel Biya chassait les barons d'Ahidjo du gouvernement – et à cause de l'entêtement d'Ahidjo à vouloir revenir aux affaires, l'effondrement de l'U.N.C. eût été irrémédiable si la France n'était pas intervenue. Le 27 août au matin, Ahidjo jurait qu'il ne démissionnerait jamais de la présidence de l'U.N.C. A midi il recevait la visite du socialiste Guy Penne (conseiller du président de la République française pour les affaires africaines). L'après-midi, il démissionnait de la présidence de l'U.N.C. Cette démission ouvrait la voie à la restauration du parti unique, en permettant à Biya d'être porté à la tête du parti lors du congrès extraordinaire de sept. 83. Les Kamerunais retiendront que c'est l'intervention de la France qui a donné un coup d'arrêt à l'effondrement du parti unique et empêché ainsi une évolution vers le multipartisme. Ceci est un fait d'une importance historique. Coiffant un parti qu'il ne contrôlait pas, Biya aura beaucoup de mal à ranimer ce parti. Il croira y être parvenu au congrès de Bamenda où l'U.N.C. se mua en R.D.P.C. De fait le parti connut après ce congrès un regain d'activité. Mais ce fut bien éphémère. Aujourd'hui on assiste à nouveau à sa déconfiture. Il ne s'agit pas seulement d'une déconfiture en tant qu'organisation, mais surtout d'un échec politique et économique retentissant que nous venons d'analyser. Le parti unique néocolonial est incapable d'assurer le développement économique et le progrès social dont le pays a besoin. C 2 – Il n'y a à l'heure actuelle aucun argument, ni politique, ni juridique, ni sociologique qui interdise l'instauration de la démocratie et du multipartisme au Kamerun. Toutes les allégations du chef de l'État sur les 200 ethnies qui seraient un obstacle au pluralisme des partis, ou sur l'immaturité des Kamerunais, ne sont absolument pas sérieuses. Comme l'indépendance, la démocratie s'instaurera au Kamerun. Mais comme l'indépendance aussi, elle sera le fruit d'une lutte persévérante. C 3 – Cette lutte, pour aboutir, nécessite l'union de toutes les forces vives du pays; pour construire un vaste courant d'union nationale pour le changement démocratique sur la base de trois revendications minimales.
2 – Légaliser l'U.P.C. et appliquer l'art. 3 de la constitution; 3 – Respecter les droits de l'homme. A la fin de son livre « Où va le Kamerun », Woungly Massaga écrit : « Les trois forces – l'armée, le gouvernement de Biya, l'U.P.C. – [PAGE 254] sont, dans une certaine mesure, libres de leur choix; mais le choix de chacune influera sur le comportement et le choix des autres. C'est pourquoi la situation actuelle les place toutes les trois face à une exigence de Salut National ». Le gouvernement de M. Biya n'a pas voulu entendre ce message et au lieu du salut national il conduit la nation vers la perdition. Il est aujourd'hui totalement disqualifié. Aucune hypothèse de redressement de la situation ne peut se fonder sur Biya et son équipe. Doit-on conclure pour autant que tout repose désormais sur les deux autres forces – l'U.P.C. et l'armée ? non, en tant que force d'intervention et d'influence dans le pays; oui, en tant que forces organisées. Les milieux d'affaires kamerunais, traditionnellement en retrait par rapport aux questions politiques, pourraient jouer un plus grand rôle. Les églises, dont l'influence est grande dans notre pays jouent, incontestablement un rôle politique. L'Armée : L'armée kamerunaise n'est pas un corps monolithique. Elle est traversée par les divisions de la société kamerunaise, en plus des siennes propres qui sont essentiellement l'œuvre d'Ahidjo qui l'avait émiettée pour l'affaiblir. La réorganisation entreprise par Biya ne peut pas avoir effacé ces divisions comme par un coup de baguette magique. Au contraire, il les a accentuées par sa politique tribaliste. Bien que sous Ahidjo elle ait participé à la répression sanguinaire anti-populaire et à la chasse aux sorcières contre les upécistes, – chasse qui était, rappelons-le surtout le domaine du S.E.D.O.C. de Fochivé –, et bien que des officiers supérieurs aient fait échouer en 1979 une tentative de putsch des sous-officiers, son image de marque dans le pays n'était pas trop négative. Elle est même devenue franchement positive en 1984 lorsqu'elle a écrasé le coup d'État avorté des partisans d'Ahidjo. Le peuple kamerunais lui est reconnaissant d'avoir empêché le retour du criminel au pouvoir, même si les méthodes utilisées furent démesurément brutales et sans discernement. En se montrant loyaliste sans pour autant revendiquer le pouvoir, l'armée a fait la preuve non seulement de son patriotisme, mais aussi de son sens des responsabilités. Devant la dégradation présente de la situation nationale, quatre voies s'ouvrent devant elle :
b) Une voie moyenne où l'armée resterait dans les casernes, jouant le rôle de gardienne de la sécurité du pays avec patriotisme et responsabilité, en refusant de se livrer au massacre des populations si un nouveau chef plus « musclé » venait au pouvoir, ou si un soulèvement populaire se produisait. c) Une voie avancée où l'armée, en coopération avec les autres forces patriotiques, rechercherait une solution pour une transition démocratique. d) Enfin une voie aventuriste où l'armée, ou une fraction de l'armée, confisquerait le pouvoir pour elle-même, et, sous couvert d'une phraséologie de gauche, conduirait inévitablement le pays à la situation peu enviable de certains régimes militaires africains réputés progressistes. « Certes, les chefs militaires, et notamment le Général Semengué, chef d'état major des armées, ont prouvé leur attachement à la légalité républicaine. Mais cette preuve de maturité civique ne s'est pas accompagnée, loin s'en faut, de la démonstration d'une maturité politique (sic). Les déclarations du Général Semengué et de M. André Tchoungui, ministre des forces armées, sont même apparues comme une bien inutile provocation nordiste. » Feignant d'ignorer que M. André Tchoungui, qui est un civil et non un militaire, parlait en tant que membre du gouvernement et que le Général Semengué, qui était aux côtés du ministre pendant la conférence de presse, n'a fait que répéter les propos de son chef, Le Monde essaie de faire porter à l'armée la responsabilité de cette déclaration, effectivement maladroite, selon laquelle la tentative de coup d'État du 6 avril était « un complot nordiste » (Le Monde 17 avril 1984) et se fonde sur cette falsification pour intimer au président Biya l'ordre de mettre l'armée au pas : « M. Biya devra (souligné par S.K.) sans doute (le « sans doute » n'est ici qu'une clause de style) profiter de son avantage (mais quel avantage ?) en achevant la réorganisation (sic) de l'armée afin que le principe intangible de la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire soit ancré dans les esprits. » Mais les militaires, à ce que l'on sache, n'ont pas mis en cause cette [PAGE 256] suprématie. Leur comportement durant la tentative du putsch démontre précisément le contraire. L'influence de l'église notamment de l'église catholique est importante au Kamerun. Elle l'était déjà lors de la lutte pour l'indépendance. Chacun se souvient du rôle de Mgr Thomas Mongo dans les contacts entre R. Um Nyobé et l'administration coloniale. Malheureusement les églises souffrent de trois tares extrêmement graves : l'anti-communisme, le tribalisme et la corruption de leurs dignitaires. L'anti-upécisme est la version kamerunaise de l'anti-communisme. Cette maladie est chronique dans l'église car Um Nyobé en avait déjà souffert. Tant que l'église continuera à considérer l'U.P.C. comme « le diable », son rôle politique national ne pourra être que néfaste. Car l'U.P.C. n'est pas « le diable » – faut-il encore le démontrer, après tant de sacrifices de ses membres pour le pays ? –; et qu'on le veuille ou non, aucun schéma politique faisant fi de son existence ne peut réussir au Kamerun. La corruption et le tribalisme vont souvent de pair, car le support principal du tribalisme, ce sont les considérations matérielles. Dans les églises où existe une relative homogénéité tribale parmi les ministres du culte, l'entente n'est pas cordiale entre ceux-ci. Les uns ne supportent pas que d'autres s'enrichissent démesurément, au point de posséder des maisons, des voitures, des écoles, et même des entreprises ! Alors que dans le même temps des maîtres d'écoles confessionnelles ne sont pas payés. Dans les églises de Douala où la composition tribale des ministres du culte est très hétérogène, reflétant la composition multi-ethnique de cette ville, les querelles et les jalousies entre dignitaires de l'église prennent tout de suite des allures de tribalisme. C'est au moins une des explications de l'hystérie anti-bamiléké qui a secoué les églises de Douala ces derniers temps, aussi bien l'église catholique avec l'affaire de la nomination de Mgr Sime, que l'église protestante après l'échec du pasteur Kato aux élections pour la présidence de cette église et ensuite après son décès. En se livrant à ces manifestations tribales indignes d'elles les églises donnent prise, de surcroît, aux stratèges du néo-colonialisme qui cherchent à diviser les Kamerunais et à préparer un exutoire à la crise. On pourrait dire la même chose des intellectuels « mono-Ndjaneux ». Les milieux d'affaires : Les hommes d'affaires kamerunais n'ont jamais occupé le devant de la scène politique kamerunaise. Depuis que Soppo Priso refusa de prendre en charge les rênes de l'Etat que lui offrait l'administration coloniale avant l'indépendance, la scène politique est entièrement occupée par Ahidjo et l'U.P.C. (jusqu'en nov. 1982). La plupart des commerçants et entrepreneurs qui avaient financé l'U.P.C. pendant la lutte pour l'indépendance cessèrent de le faire après l'indépendance, soit parce que celle-ci correspondait à leur objectif, soit par peur de la répression. En effet, sous Ahidjo la prospérité était garantie pour ceux qui trahissaient les upécistes. Ceux qui gardaient leur dignité sans trahir l'U.P.C. ni [PAGE 257] collaborer avec elle avaient quelque chance qu'on les laisse faire leurs affaires tranquillement. Quant à ceux dont la sympathie upéciste était connue ou suspectée, leur commerce était asphyxié ou tout simplement saccagé ou brûlé. Terrorisés par tout ce qui touche de près ou de loin à « la politique » au sens étroit du terme, les hommes d'affaires kamerunais crurent que le seul moyen de préserver leur commerce ou leur entreprise était de se transformer en courtisans des politiciens. Et pendant des années et des années, et jusqu'à ce jour, ils furent les vaches à lait consentantes des politiciens et des technocrates. Beaucoup de technocrates, bureaucrates et politiciens sont devenus hommes d'affaires, mais bien peu d'hommes d'affaires sont devenus politiciens. Ils ont financé Ahidjo et ses barons pendant 25 ans, pour avoir le droit de faire leurs affaires tranquillement, en fermant les yeux sur les crimes du tyran. En cela ils portent leur part de responsabilité dans cette tyrannie. Mais ils ont constaté eux-mêmes en 1982 (voir la motion de soutien à Biya) que ça ne « marchait » plus. Ils ont financé Biya et ses technocrates. Mais l'échec est encore plus rapide et plus grave. Ils sont aujourd'hui amers. Il leur faut réfléchir, et choisir : ou bien ils continuent à gaspiller leur argent pour rien sinon pour se faire les complices de la dictature et de l'incompétence, ou bien ils discutent avec les forces patriotiques – l'U.P.C., les éléments progressistes au sein de l'armée, au sein du R.D.P.C. lui-même, au sein du peuple – pour mettre au point un nouveau programme politique qui permettra d'assainir la situation. Il est vrai que l'application d'une telle politique comportera nécessairement une certaine perte d'argent pour eux. Mais cet argent servira à la prospérité de l'ensemble du pays et non à quelques individus peu scrupuleux et peu soucieux de l'intérêt national comme c'est le cas actuellement. – L'U.P.C. a montré par sa souplesse et le sérieux de ses propositions au cours de ces cinq années de gouvernement Biya, qu'elle était ouverte à cette recherche commune d'une solution juste au problème kamerunais. Malgré tous les efforts déployés pendant des décennies par les colonialistes français, puis par Ahidjo, et maintenant par les technocrates « bardés de diplômes » pour salir l'image de l'U.P.C. présentée comme violente et intransigeante, cette image est restée aux yeux des masses populaires celle du parti par lequel l'indépendance est venue, d'un parti défenseur des intérêts nationaux, des intérêts du peuple, d'un parti héroïque. Tous les discours officiels sur les forces centrifuges du tribalisme, sur l'immaturité du peuple kamerunais, sur la prématurité du moment actuel pour la démocratisation, sur la précipitation de l'U.P.C. qui voudrait « tout tout de suite », toutes les insultes de certains intellectuels sur les prétendues « erreurs néfastes pour les institutions et les citoyens »[21] commises par l'U.P.C., etc. cachent mal une préoccupation majeure : ils craignent tous qu'un processus de démocratisation [PAGE 258] réelle ne fasse la part belle à l'U.P.C. Mais pourquoi diable a-t-on si peur de l'U.P.C. ? Qu'on veuille bien relire l'histoire et on verra de quel côté est venue la violence ! Ce n'est pas l'U.P.C. – mais bien l'administration coloniale – qui a tiré sur les foules en 1955, faisant plus de 5 000 morts dans les rues de Yaoundé, Douala, Nkongsamba etc. Ce n'est pas l'U.P.C., mais bien Ahidjo, qui a arrêté, emprisonné, torturé, assassiné des centaines de milliers de Kamerunais pendant 25 ans. Ce n'est pas l'U.P.C., mais Biya, Ahidjo et les Français qui sont responsables de la mort de milliers d'innocents à Yaoundé en avril 1984. Ce n'est pas l'U.P.C., mais bien Biya qui a fait exécuter après des procès sommaires des soldats et des civils après avril 84 etc. etc. et encore etc. Quand la violence répond à la violence, elle est légitime ! A propos des « erreurs néfastes pour les institutions et les citoyens Camerounais », l'honnêteté commandait à l'auteur de ces accusations de préciser à quelles erreurs il fait allusion. L'U.P.C. a commis des erreurs, bien évidemment, comme tous partis ou tout individu actifs. Seuls ceux qui ne font rien ne commettent jamais d'erreur. Elle les a d'ailleurs reconnues et a fait son autocritique en 1982[22]. Mais de là à absoudre complètement les colonialistes français, puis Ahidjo, puis Biya, et à faire porter à l'U.P.C. la responsabilité des malheurs de notre pays, et à faire d'elle l'obstacle à l'ouverture démocratique dont le pays a besoin, il faut pour cela plus que de la malhonnêteté, il faut une forte dose de haine contre le parti qui défend les intérêts du peuple. C'est en effet considérer l'U.P.C. comme l'obstacle au changement que d'affirmer, comme le fait Kegne Pokam[23] que « ceux qui se réclament aujourd'hui de l'U.P.C. s'enlisent dans les mêmes méthodes (l'intransigeance) qui risquent de conduire le président Paul Biya à la radicalisation du « renouveau national » et au renvoi sine die de l'ouverture démocratique amorcée ». Cette manifestation haineuse contre l'U.P.C. traduit la contradiction insurmontable dans laquelle s'est enfermée la petite bourgeoisie – notamment les couches intellectuelles favorables au changement – : d'une part ils veulent la démocratie, le multipartisme, mais d'autre part ils ne veulent pas l'U.P.C., le parti du peuple, ce « petit peuple » qu'ils méprisent tant. C'est là une position intenable. Chacun peut faire le raisonnement suivant (et nos contradicteurs l'ont sûrement fait, ce qui les jette dans le désarroi) :
2 – L'article 3 de la constitution prévoit le multipartisme. Il n'y a qu'à l'appliquer. 3 – Si on l'applique on légalise ipso facto l'U.P.C., car en bonne logique on ne peut autoriser la création de nouveaux partis, sans laisser [PAGE 259] fonctionner celui qui existe déjà, et qui, de surcroît est le plus vieux parti politique du Kamerun, celui qui a lutté pour l'indépendance ! Dans l'esprit des technocrates bardés de diplômes, des Kegne, et des anti-upécistes de tout acabit, le raisonnement se bloque à ce niveau. Comment mettre en œuvre le multipartisme sans légaliser l'U.P.C ? C'est la quadrature du cercle. En somme, ce qui leur ferait un immense plaisir c'est que l'U.P.C. se saborde pour permettre l'existence de partis politiques ayant leur préférence ! Ils peuvent toujours rêver... Comme leur rêve ne se réalise pas, ils se livrent à l'insulte, au mensonge, à la haine contre l'U.P.C. Ils ressuscitent le thème mythique de la propagande coloniale qu'est la prétendue intransigeance de l'U.P.C. Chacun peut observer que le comportement de l'U.P.C. face à Biya relève de tout ce qu'on veut sauf de l'intransigeance. L'U.P.C. a écrit à Paul Biya dès janvier 83 pour lui proposer d'élaborer en commun « une politique de changement dans la stabilité ». – L'U.P.C. a soutenu Biya sans rien demander en contrepartie. – L'U.P.C. a proposé à Biya de ne pas présenter de candidat contre lui pour l'élection présidentielle de 1985 s'il engageait l'ouverture démocratique. – L'U.P.C. a proposé la même attitude constructive à l'égard des députés partisans du changement démocratique, pour les élections législatives. Quelle concession supplémentaire pouvait-on encore attendre de l'U.P.C. ? Sa disparition pure et simple de la scène politique nationale ? Rêve insensé. Ceux qui ont pris ces concessions pour des signes de faiblesse de l'U.P.C. n'ont pas tardé à déchanter, et ils déchanteront encore. En conclusion La situation économique et politique catastrophique du Kamerun ne résulte pas seulement de la faillite des « technocrates bardés de diplômes » dont on disait avec force propagande qu'ils allaient bien gérer l'économie. L'équipe de M. Biya a seulement accéléré, par un pillage incroyablement effréné et rapide des richesses nationales, par des erreurs de gestion impardonnables et par une indécision politique rare, une crise politico-économique qui vient de loin. En effet la crise kamerunaise est essentiellement celle du néo-colonialisme, celle de la dictature du parti unique néo-colonial. Cette réalité doit absolument être prise en compte dans la recherche d'une alternative au régime de Paul Biya. Il faut éviter l'illusion selon laquelle il suffirait de changer les hommes pour que tout aille bien. Les changements intervenus depuis le 6 novembre 1982 montrent que cela n'est pas suffisant. Il faut un changement politique, une réelle ouverture politique. Les milieux d'affaires, l'armée et l'U.P.C. sont les trois principales forces qui peuvent influer actuellement sur cette évolution. Elles ont le devoir national de collaborer à la recherche d'une solution. La France [PAGE 260] néo-colonialiste n'aurait alors que peu de prise sur un corps national solidaire. L'intervention de la France dans les affaires intérieures du Kamerun n'a jamais été bénéfique pour le pays. Au contraire. Que ceux de nos compatriotes qui seraient tentés de solliciter cette intervention, ou de lui donner prise se souviennent bien : 1955, les troupes de Roland Pré tirent dans la foule : 5 000 morts. 1958, Ramadier renverse Mbida et met Ahidjo à sa place : 25 ans de répression. 1983, la France – socialiste – contraint Ahidjo à démissionner de la présidence de l'U.N.C. et met en échec le processus qui allait vers le multipartisme. 1984, la France aide Ahidjo à reprendre le pouvoir : 2 000 morts. A combien de morts la prochaine intervention ?
Siméon KUISSU
[1] Le 5e plan de développement économique et social. Publication du ministre du plan et de l'aménagement du territoire. Yaoundé. [2] Le 5e plan..., op. cit. [3] « La Voix du Kamerun », no 28, Éditorial. [4] « La Voix du Kamerun », no 53, sept. 86. [5] Le 5e plan..., op. cit. [6] Le 5e plan..., op. cit. [7] Le 5e plan..., op. cit. [8] Le 5e plan..., op. cit. [9] Le 5e plan..., op. cit. [10] « La Voix du Kamerun », no 53, sept. 86, op. cit. [11] « La Voix du Kamerun », no 53, sept. 86, op. cit. [12] Le 5e plan..., op. cit. [13] Le 5e plan..., op. cit. [14] Voir liste du bénéficiaire de ces crédits dans « La Voix du Kamerun », no 57, sept. 87. [15] Le 5e plan..., op. cit. [16] Le 5e plan..., op. cit. [17] « Le Nouvel Économiste », no hors série, juin 87. [18] Voir notamment la lette de l'U.P.C. à Paul Biya, dans « Où va le Kamerun ? », p. 152. Édition L'Harmattan, 5-7, rue de l'Ecole Polytechnique, Paris 5e. [19] « Droits de l'homme 1982-1986 ». Edité par le C.D.A.P.P.C. (Comité pour Défendre et Assister les Prisonniers Politiques au Cameroun), chez Maître Lucienne Didner-Sergent, 3, rue Thimmonier, 75009 Paris. [20] Bulletin du C.H.C.R. (Committee for Human Rights in Cameroon). BM BOX 551 London WC 1 N 3 XXX GB. [21] « Le Messager », no 115 du 29.08.97. [22] « Le 3e congrès de l'union du populations du Cameroun ». Publication du comité central de l'U.P.C. s/c Dr. S. Kuissu, B.P. 32, Nogent/Oise, 60101 Creil cedex (France). [23] « Le Messager », op. cit. |